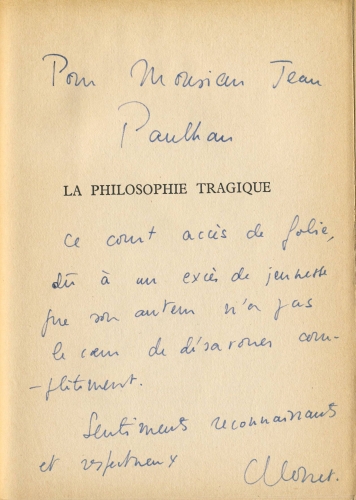28/03/2018
R.I.P. Clément Rosset, 1939-2018
« Je suis au bord d’un bras de mer qui me sépare d’une côte située au large. Survient quelqu’un qui me dit : « D’ici une heure ou deux, une barque viendra vous prendre pour vous transporter là-bas ». J’acquiesce mais me demande pourquoi je dois aller là-bas, où je n’ai rien à faire. Il est vrai que je n’ai rien à faire ici non plus.
Au-delà de l’allusion claire au fleuve des morts et à son nocher Caron, le plus pénible est ici le sentiment, persistant après le réveil, que je ne sais ni ce qu’il y a là-bas, ni ce qu’il y a ici, ni qui m’a parlé, ni qui je suis. Il ne reste qu’à continuer à ne rien faire, comme L’innommable de Beckett. »
Clément Rosset, Le monde perdu
« Le secret qu’il ne faut pas connaître, et que l’épouse de Barbe-Bleue finit par connaître malgré elle en pénétrant dans la chambre interdite est tout d’abord, et tout simplement, la mort. La mort des autres et, à travers elle, sa propre mort, tout à la fois éloignée et prochaine. La découverte de ce secret marque la fin de la vie heureuse et le début d’une période de désolation et de tristesse. À l’inverse de l’agneau de Dieu qui efface tous les péchés du monde, la connaissance de la mort efface tous les bonheurs de la terre. L’avertissement de Barbe-Bleue était justifié : si vous percez ce secret, il n’est rien que vous ne deviez attendre de ma colère, – si vous connaissez cela, vous ne connaîtrez jamais plus aucun bonheur. C’est la connaissance de la mort qui neutralise tous les appétits, rendant vains et comme caduques les innombrables dons qui s’offrent à la perception humaine. Caduques en effet : car tout ce qui doit périr est déjà comme mort, et c’est le cas de tout ce qui peut nous échoir, y compris notre propre personne, qui viendront ainsi trop tard s’offrir à notre jouissance. Trop tard d’un savoir, du savoir de la mort. Ce quelque chose d’amer qui trouble toute jouissance est bien la mort, la menace qui pèse sur notre bonheur est la mort.
Quelle est précisément cette mort qu’il ne faut pas connaître, sauf à perdre tout droit à la jouissance ? Elle n’est évidemment pas cette représentation lointaine du fait de mourir comme nécessairement attaché à l’espèce humaine, dont il m’arrive parfois de me rappeler vaguement que je fais partie moi aussi : car le savoir de ma mort s’est dilué dans ces représentations et ces rappels, au point de perdre tout le fort de son venin. Mais elle n’est pas non plus seulement, et pas surtout, le savoir de ma mort, conçue comme échéance immédiate et sans recours. Car ma mort, même ainsi saisie comme à vif, ne serait encore qu’un moindre mal. Elle signale une découverte affligeante mais dont on peut se consoler, si elle ne concerne que la fragilité de ma propre personne, vouée au non-être et à l’oubli. En ces sens-là la mort ne constitue pas une dévaluation mais une perte, et une perte simple, pour employer le langage des jeux. Je suis condamné à la mort – c’est-à-dire que je vais me perdre, je vais perdre moi – mais les objets que j’ai thésaurisés au cours de ma vie n’en sont pas pour autant dévalués ou disqualifiés. Je meurs, mais reste ce que j’ai aimé au cours de ma vie éphémère : par exemple un certain art grec, une certaine élégance, une certaine allégresse. Je disparais, mais il y aura toujours à admirer les frises de Phidias, les tragédies de Shakespeare, les opéras de Mozart.
Une telle pensée de la mort n’est pas encore véritablement mortelle. La pensée qui blesse à mort n’est pas le savoir de ma disparition, mais celui de l’égale disparition, à plus ou moins long terme, de toute chose susceptible de me séduire, comme de séduire tout un chacun. Ce n’est pas seulement moi qui aime qui suis voué à la mort, c’est aussi tout ce que j’aime et tout ce que je serais susceptible d’aimer s’il m’était donné un temps de vie plus long et un plus vaste champ d’expérience. Ce fruit que je goûte est plus fragile que moi, même s’il est taillé dans le marbre ou inscrit depuis des millénaires dans le cœur et l’admiration des hommes. C’est pourquoi il laisse un goût amer, comme le dit Lucrèce, et d’autant plus amer qu’il est plus précieux. On est encore loin du tragique de la mort lorsqu’on s’avise avec désolation de la nécessité où l’on est de mourir soi-même, de quitter un jour tout ce qu’on aime. Car, à y regarder de près, le cela que je quitte n’en a pas lui non plus pour bien longtemps, et m’a même quitté déjà en partie, dès le moment que j’en ai repéré la fragilité. L’œuvre d’art que j’admire, la personne que j’aime, le livre que j’écris ne me survivront pas ou guère, et j’en vois déjà la disparition en filigrane alors que je suis moi toujours en vie. Ce n’est pas moi qui quitte tout cela ; c’est, plus profondément, tout cela qui me quitte, que j’aime sans pouvoir l’arracher à la mort. Et c’est en cela que le savoir de la mort est mortel : en ce que, parti de moi, il a proliféré de proche en proche pour gagner toute chose au monde, condamnant ainsi à la mort non seulement moi-même, mais aussi tous mes objets d’amour ou d’intérêt.
Ce double visage de la mort – chacun terrible mais le second bien davantage que le premier – se trouve exprimé dans une brève formule de l’Art poétique d’Horace : Debemur morti nos nostraque – nous sommes dus à la mort, nous et « nos choses ». Nos nostraque : nous et toutes nos affaires ; nous, mais aussi Phidias et Shakespeare. Ce qui meurt est bien moi, mais aussi tout ce dont ce moi a été instruit et nourri : c’est-à-dire tout ce qui s’est présenté ou aurait pu se présenter à moi d’aimable ou d’admirable. Le sujet meurt, mais aussi tous ses compléments d’objet possibles. Ce qui signifie que tout ce à quoi je puis m’intéresser est aussi fragile que moi qui m’y intéresse. Cela est de grande conséquence, et l’amplitude du désastre laisse dans l’ombre le malheur de ma mort personnelle, que j’offrirais bien volontiers en échange d’une remise de cet holocauste universel. Mais il est trop tard, et l’oubli de soi n’est plus ici d’aucun secours : quand tout est mort il ne sert de rien de faire, en catastrophe, le sacrifice de sa propre existence. Comme le dit saint Augustin, dans le De immortalitate animae : « La mort que l’âme doit vaincre n’est pas tant l’unique mort qui met fin à la vie, que la mort que l’âme éprouve sans cesse durant qu’elle vit dans le temps. »
Le pouvoir de la mort, qui est sans commune mesure avec ma mort, sans commune mesure même, comme on va le voir, avec le fait que tout meure, que tout ait une fin, est donc finalement assez semblable à celui – exorbitant aux yeux de certains théologiens – reconnu à Dieu par saint Pierre Damien dans son Traité de l’omnipotence divine : pouvoir d’annuler le passé, de faire en sorte que ce qui a eu lieu n’ait pas lieu. La mort n’est pas seulement la fin de la chose ; elle est aussi et surtout son annulation. Aucune chose n’existe ni n’a existé, puisque sous menace d’être bientôt à jamais biffée par l’oubli, en sorte qu’il n’y aura, tôt ou tard, plus de différence entre « ceci s’est passé » et « ceci ne s’est pas passé ». Équivalence morose dont l’expérience est fournie déjà par le présent : par l’oubli où sont comme déjà, de ce qui est ici ou là, tous ceux qui ne sont ni ne seront jamais ici ou là. C’est là un des derniers mots de Mallarmé (dans le Coup de dés) et l’expression ramassée de la pensée qui paralysait sa faculté créatrice depuis toujours : « rien n’aura eu lieu », – rien, pas même la poésie. Le pouvoir de Dieu est celui du Diable : les deux se confondent dans ce pouvoir outrecuidant de la mort qui est d’annuler ce qui a existé, de faire en somme que ce qui existe n’a pas d’existence. Le monde ne souffre pas de devoir finir, il souffre de ne pas avoir commencé : de ne pas avoir encore « eu lieu ».
Clément Rosset, Le Réel : Traité de l’idiotie
13:25 | Lien permanent | Commentaires (0)