16/05/2007
Licentia utendi
19:45 | Lien permanent | Commentaires (12)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« Negotium | Page d'accueil | L'Énigme du Réalisme (1) »
19:45 | Lien permanent | Commentaires (12)
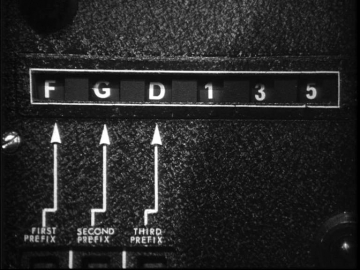

Commentaires
"À première vue je dirais : oui. Parce que si j'essaie de définir les états du troisième genre, ben, c'est quoi ? Il y a une certitude. C'est un mode de certitude très particulier que Spinoza exprime d'ailleurs sous le terme un peu insolite de "consius". Conscience, c'est une conscience. C'est une espèce de conscience, mais qui s'est élevée à une puissance. Je dirais presque c'est la dernière puissance de la conscience. Et qu'est ce que c'est ? Comment définir cette conscience ? C'est... je dirais c'est la conscience interne d'autre chose.
À savoir c'est une "conscience de soi", mais cette conscience de soi en tant que telle appréhende une puissance. Alors, cette conscience de soi qui s'est élevée, qui est devenue conscience de puissance, cela fait que ce que cette conscience saisit, elle le saisit à l'intérieur de soi. Et pourtant ce qu'elle saisit ainsi à l'intérieur de soi, c'est une puissance extérieure. Or c'est bien comme ça que Spinoza essaie de définir le troisième genre. Finalement, vous atteignez au troisième genre, ce genre presque mystique, cette intuition du troisième genre, pratiquement on pourrait dire à quoi la reconnaître. C'est vraiment lorsque vous affrontez une puissance extérieure - il faut maintenir les
deux - et que cette puissance extérieur c'est en vous que vous l'affrontez. Vous la saisissez en vous. C'est pour ça que Spinoza dit, finalement, le troisième genre c'est lorsque : être conscient de"soi-même", être conscient de Dieu, et être conscient du monde, ne font plus qu'un. Je crois que
c'est important, là, il faut le prendre à la lettre, les formules de Spinoza. Dans le troisième genre de connaissance, je suis indissolublement conscient de moi-même, des autres ou du monde, et de Dieu. Alors, ça veut bien dire, si vous voulez, c'est cette espèce de conscience de soi qui est en même temps conscience de la puissance ; conscience de la puissance qui est en même temps conscience de soi. Alors enfin, je dirais oui... pourquoi est ce que l'on est à la fois sûr et pourtant très vulnérable ? Bien, on y est très vulnérable parce qu'il s'en faut d'un point minuscule que cette puissance ne nous emporte. Elle nous déborde tellement que, à ce moment-là, tout se passe comme si on était abattu par l'énormité de cette puissance. Et en même temps, on est sûr. On est sûr parce que précisément l'objet de cette conscience si extérieur qui soit en tant que puissance, c'est en moi que je le saisis. Si bien que, Spinoza insiste énormément sur le point suivant, le bonheur du troisième genre auquel il réserve le nom de béatitude, cette béatitude, ben... c'est finalement un étrange bonheur. C'est-à-dire
que c'est un bonheur qui ne dépend que de moi. Est-ce qu'il y a des bonheurs qui ne dépendent que de moi ? Spinoza dirait : c'est une fausse question de se demander est ce qu'il y en a. Puisque c'est vraiment le produit d'une conquête. La conquête du troisième genre, c'est précisément d'arriver à des états de bonheur où en même temps il y ait certitude que ça, quoi qu'il arrive, personne, d'une certaine manière, ne peut me les ôter. Tout peut arriver. L'idée... vous savez on passe parfois par des états comme ça. Hélas, non
durables. Quoi qu'il arrive, ah ben oui... peut-être que je pourrai mourir... oui, d'accord. Mais ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas me retirer c'est, à la lettre, cet étrange bonheur. Alors ça, Spinoza dans le Livre V, je crois, le décrit très, très admirablement. D'où je reviens plus à la première question qui elle est plus...Oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais donc je dirai, oui, c'est... ce qu'on appelait la dernière fois, ce que j'appellais l'auto-affection, c'est précisément cette conscience de la puissance qui est devenue conscience de soi. Alors, peut-être que l'art, l'art présente ces formes de conscience, particulièrement... sous une forme particulièrement aigüe. L'impression de devenir invulnérable...ah, ben ça, oui. Je n'arrive pas à dire l'extraordinaire modestie qui accompagne cette certitude. C'est une espèce de certitude de soi qui pèse et là ensuite, dans une modestie, c'est-à-dire, c'est comme le rapport avec une puissance." (Deleuze)
Écrit par : (P[h]i) | 16/05/2007
Sarkozy est-il absolu?
Écrit par : nicolas | 16/05/2007
Il avait dû redoubler. Ou alors c'est Gilou qui a sauté la CM1.
Écrit par : sk†ns | 17/05/2007
Quelle drôle d'idée, Nicolas. Vous savez bien en effet que l'homme n'est pas sans relations. Ne surestimez-vous pas, en tant que telle, la puissance de la petite frappe ?
On va le savoir qu'il a sauté, sk†ns. Sinon, étant né en début d'année civile, Deleuze était l'un des plus âgés de sa classe de Carnot (cf. l'abécédaire), excepté donc pour Môquet et peut-être quelques autres.
Écrit par : Anaximandrake | 17/05/2007
Je parlais de sa capacité (mais elle ne lui est pas propre, loin de là) de passer, sans raison, d'un état à l'autre.
Écrit par : nicolas | 17/05/2007
"vous savez on passe parfois par des états comme ça. Hélas, non
durables."
Durables ils sont la négation de l'art, qui leur court après.
Durables, ils restent sans témoignage.
Écrit par : Anonyme | 17/05/2007
« L'absolu est le passage possible, et dépourvu de raison, de mon état vers n'importe quel autre état. » (Meillassoux)
Plasticité de l'absolu qui ne renonce à sa fixité, dans le relatif des passages vers n'importe quelle situation.
Écrit par : Anonyme | 17/05/2007
J'ai pas dit non plus qu'il avait pris son envol !
Écrit par : sk†ns | 17/05/2007
Le commmunisme est le passage nécessaire, et tout à fait rationnel, de ma nation vers n'importe quelle autre nation.
Écrit par : L'Internationale | 17/05/2007
Que reste-il de l'absolu ?
J'ai déniché cet article d'Arnaud Spire dans l'humanité du 13 mars 2001.
Avec la traduction de Vérité et justification, l’avenir qu’envisage Habermas pour la philosophie n’est ni sa résorption dans la science, ni sa dérive vers le spiritualisme. La traduction d’allemand en français de Vérité et justification de Jürgen Habermas (1), montre à ceux qui en douteraient que le dernier survivant de l’École de Francfort, malgré ses incursions dans les domaines de la communication, du droit et de la politique, continue bien de s’inscrire dans la lignée des philosophes allemands de l’histoire qui n’ont cessé d’instruire jusqu’à nos jours le procès de la raison historique. L’idée critique que le " pouvoir du progrès " a entraînée jusqu’ici un " progrès du pouvoir " (au sens de renforcement totalitaire) est aujourd’hui - bien au-delà de la philosophie allemande - à la disposition de tous ceux qui, interprétant le monde de diverses façons, rêvent de le transformer sans lui sacrifier l’émancipation humaine. Si l’homme s’est progressivement émancipé de la nature grâce au développement de la raison, cette dernière se manifeste à travers une domination qui a atteint son paroxysme au XXe siècle, avec les camps d’extermination et les guerres ethniques.
Examinant le regard que le philosophe américain Richard Rorty jette aujourd’hui sur son propre itinéraire philosophique, Habermas critique " cette manière de philosopher dont le but est de congédier la philosophie ". Les deux philosophes entretiennent depuis des lustres un débat sur la fonction du langage qui, en même temps qu’il limite les possibilités d’accès de l’homme à l’absolu, constitue le seul moyen d’accéder à la connaissance de la vérité. Selon Habermas, Richard Rorty nourrit - comme beaucoup de ses prédécesseurs depuis deux siècles - le projet d’en finir avec toute philosophie. Mais cette orientation, remarque Habermas, " est celle d’un métaphysicien déçu [...] , plutôt que l’autocritique d’un penseur analytique éclairé, souhaitant mener le tournant linguistique jusqu’à son terme pragmatiste ". Ce qui manque à Rorty, c’est une pensée qui, comme celle de l’École de Francfort, reste " solidaire de la métaphysique à l’instant de sa chute " (2). C’est cette complexité d’une critique qui dépasse plutôt qu’elle n’abolit, qui épouse un déclin pour échapper à la disparition de ce qui décline et trouve ainsi le ressort de l’innovation, qui explique le titre de l’ouvrage, Vérité et justification. Il n’y a bien sûr pas de vérité absolue. C’est au moment où tout ce qui y conduit s’effondre, que le caractère relatif de toute vérité apparaît comme le prolongement de tout ce qui justifiait l’ancienne vérité... Habermas écrit à propos du lien interne entre justification et vérité : " Ce lien explique pourquoi, à la lumière des preuves disponibles, nous sommes en droit d’élever une prétention à la vérité inconditionnelle au-delà de ce que nous justifions " (page 183). La vérité est à la fois tension vers l’absolu et critique de tout caractère définitif qu’on pourrait lui attribuer...
Hans-Georg Gadamer, centenaire depuis peu et l’un des principaux disciples allemands d’Heidegger, a le premier essayé de concilier les philosophies continentales de l’histoire avec l’univers analytique anglo-saxon. Un texte inédit de lui, intitulé Au commencement de la philosophie : pour une lecture des Présocratiques (3) - et reprenant des cours donnés en 1988 à l’Institut philosophique de Naples - s’adresse spécifiquement à tous ceux qui cherchent à " relier l’état actuel de la philosophie à ses origines ". Il s’agit d’une tentative visant à situer dans l’Antiquité grecque la naissance de l’herméneutique (pluralité d’interprétations possibles d’un texte) dans la philosophie. Pour Gadamer, la puissance de la philosophie réside dans la multiplicité des interprétations possibles, à la différence d’Habermas qui reproche aux " herméneutes " (et notamment à Gadamer) comme aux positivistes leur conservatisme. Pour Habermas, la transformation du monde - si jamais il y croit encore - ne peut qu’aller de pair avec la diversité et la pluralité des interprétations.
A.S
(1) Vérité et justification, par Jürgen Habermas. Traduit par Rainer Rochlitz. Collection Essais, Éditions Gallimard, 352 pages.
(2) La Dialectique négative, de Adorno, Cité par Habermas, 170 pages.
(3) Au commencement de la philosophie : pour une lecture des Présocratiques, par Hans-Georg Gadamer, traduit par Pierre Fruchon, puis par Dominique Séglard, collection Traces écrites, Le Seuil. 160 pages
Écrit par : Blog-trotter | 17/05/2007
"Et que il y a une vitesse des scolies qui est vraiment une vitesse de l’affect. Par différence avec la lenteur relative des démonstrations qui est une lenteur du concept. Comme si dans les scolies des affects étaient projetés alors que dans les démonstrations des concepts sont développés. Donc ce ton passionnel pratique - peut-être qu’un des secrets de l’Ethique est dans les scolies - et j’opposais à ce moment-là une espèce de chaîne continue des propositions et démonstrations, continuité qui est celle du concept, à la discontinuité des scolies qui opère comme une espèce de ligne brisée et qui est la discontinuité des affects." (Deleuze)
"S’il est vrai que la philosophie de Spinoza procède comme et par un étalement sur une espèce de plan fixe. Si il y a bien cette espèce de plan fixe spinoziste où toute sa philosophie s’inscrit. C’est évident que à la limite l’immobilité absolue et la vitesse absolue ne font plus qu’ UN."(Deleuze)
"Or, Bergson commence par une étude des multiplicités numériques. Et son étude, je crois, comprend un principe très original : non pas qu'il y ait une multiplicité de nombres, mais chaque nombre est une multiplicité, même l'unité est une multiplicité. Et de cela découle trois thèses, que je résume seulement :
I/ La réduction du nombre à des notions exclusivement cardinales : le nombre comme collection d'unités, et la définition ordinale du nombre d'une collection est purement extrinsèque ou nominale, le dénombrement n'ayant d'autre but que de trouver le nom du nombre déjà pensé.
2/ L'espace comme condition du nombre, fut-ce un espace idéal, le temps qui intervient dans la série ordinale n'intervenant que secondairement, et comme temps spatialisé, c'est à dire comme espace de succession.
3/ La dursibilité de l'unité; car un nombre n'est une unité que par la colligation cardinale, c'est à dire par l'acte simple de l'intelligence qui considère la collection comme un tout; mais non seulement la colligation porte sur une pluralité d'unités, mais chacune de ces unités n'est une que par l'acte simple qui la saisit, et au contraire, est multiple en elle-même par ses subdivisions sur lesquelles la colligation porte. C'est bien en ce sens que tout nombre est une multiplicité distincte. Et il en sort deux conséquences essentielles : à la fois que l'un et le multiple appartiennent aux multiplicités numériques, et aussi le discontinu et le continu. L'un ou le discontinu qualifient l'acte indivisible par lequel on conçoit un nombre, puis un autre, le multiple ou le continu qualifiant au contraire la matière "colligée" (infiniment dursible) par cet acte.
Voilà donc comment se définissent les multiplicités numériques, et d'une certaine manière ce sont elles qui engendrent l'espace."(Deleuze)
Écrit par : Plan fixe. | 21/05/2007
Je ne connais qu'Un seul Absolu : Dieu... Le reste lui étant -intensément- plus ou moins relatif...
Ceci dit, joli moT-l'otoph...
Écrit par : pessah | 21/05/2007
Les commentaires sont fermés.