31/03/2005
Les ongles de Gilles

Dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, Diogène Laërce caractérisait philosophies et philosophes par des anecdotes symboliques, des traits lumineux et frappants. Il léguait à la postérité des singularités baignées d'une aura de légende.
Michel Cressole, auteur, en 1973, de l'une des premières études sur Deleuze, crut bon de moderniser cette méthode illustre et de la lui appliquer, mais dans une tout autre intention. Celle-ci s'apparentait, en fait, à la pure et simple commination.
En réponse, le philosophe ironique, bretteur impeccable et parodique, lui tint ce langage (Lettre à un critique sévère) :
« Exemple : mes ongles, qui sont longs et non taillés. A la fin de ta lettre tu dis que ma veste d'ouvrier (ce n'est pas vrai, c'est une veste de paysan) vaut le corsage plissé de Marilyn Monroe et mes ongles, les lunettes noires de Greta Garbo. Et tu m'inondes de conseils ironiques et malveillants. Comme tu y reviens plusieurs fois, à mes ongles, je vais t'expliquer. On peut toujours dire que ma mère me les coupait, et que c'est lié à OEdipe et à la castration (interprétation grotesque, mais psychanalytique). On peut remarquer aussi, en observant l'extrémité de mes doigts, que me manquent les empreintes digitales ordinairement protectrices, si bien que toucher du bout des doigts un objet et surtout un tissu m'est une douleur nerveuse qui exige la protection d'ongles longs (interprétation tératologique et sélectionniste). On peut dire encore, et c'est vrai, que mon rêve est d'être non pas invisible mais imperceptible, et que je compense ce rêve par la possession d'ongles que je peux mettre dans ma poche, si bien que rien ne me paraît plus choquant que quelqu'un qui les regarde (interprétation psycho-sociologique). On peut dire enfin : "Il ne faut pas manger tes ongles parce qu'ils sont à toi ; si tu aimes les ongles, mange ceux des autres, si tu veux et si tu peux" (interprétation politique, Darien). Mais toi, tu choisis l'interprétation la plus moche : il veut se singulariser, faire sa Greta Garbo. En tous cas c'est curieux que, de tous mes amis, aucun n'a jamais remarqué mes ongles, les trouvant tout à fait naturels, plantés là au hasard comme par le vent qui apporte des graines et qui ne fait parler personne. »
00:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
29/03/2005
Krisis

Avant le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, Husserl, dans La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale (la "Krisis"), s'oppose à la naturalisation des phénomènes spirituels. Son argumentation est classique et fort claire.
Selon lui, il appert que les sciences de l'esprit sont en quête de « scientificité ». Celles-ci cherchent, par un tropisme délétère, leur modèle dans les sciences de la nature. Ainsi, l'esprit est-il envisagé comme un phénomène naturel. Bien plus, ces scientifiques font dépendre l’esprit de la nature. Ils arguent que l’esprit a une base corporelle, trouve son fondement dans la « corporéité ». Selon eux, les faibles progrès des sciences de l’esprit, lorsqu’on les compare aux sciences « dures », s’expliquent uniquement par la complication des phénomènes physiques en jeu dans les phénomènes spirituels.
A l’évidence, une telle attitude pose un problème. En effet, les sciences de l’esprit ont ceci de particulier qu’elles ont pour visée la connaissance de l’esprit par l’esprit. Il serait donc absurde de vouloir connaître l’esprit en utilisant les méthodes des sciences de la nature. Ce serait ignorer que les sciences de la nature sont des productions humaines, des produits de l’esprit lui-même. Appliquer une méthode de type naturaliste à l’étude de l’esprit reviendrait à présupposer ce que l’on étudie. Ainsi, Husserl est-il conduit à formuler ce diagnostic : les sciences de la nature, en tombant dans l’objectivisme, dévient de leur sens authentique. Il ne s'agit pas de mettre en doute leur rectitude, la scientificité de leur méthode. Seulement, ces savants oublient leur propre subjectivité et veulent se placer en spectateurs. Inévitablement, ils se fourvoient dans le naturalisme psycho-physique.
Par ses succès techniques, les sciences propagent l’image d'un critère spécifique de vérité, et, par là même, s‘établit l’objectivisme. C’est pourquoi Husserl affirme : « Une science de fait donne une humanité de fait. » Oui, un universum de faits se propose comme la science totale de l’étant. C’est donc en ce sens qu’il y a « crise de l’humanité européenne ». Il se produit une rupture dans cette humanité, une sorte de divorce entre l’objectivité et la subjectivité. Le rapport authentique se renverse et les sciences prédominent sur ce qui relève en droit de la subjectivité. Ce qui est évidemment contradictoire. Mais, en outre, ce qu’Husserl nomme « les questions les plus hautes », c’est-à-dire les questions de l’existence, de son sens, et tout ce que subsument « les problèmes de la raison » sont évacués. Il est donc légitime de dire que « le positivisme décapite la philosophie ».
On peut aisément imaginer les conséquences pratiques dont la guerre fait partie. En effet, les Européens méconnaissent par là leur humanité commune et la parenté des nations s’efface au profit des nationalismes bornés. Où remontent les racines de cette crise ? Husserl suggère qu’elles germent au XVIIIème siècle, dès l’Aufklärung. C’est à cette époque en effet que le naturalisme naïf se développe. Cet éloge de la raison n’est condamnable pour Husserl qu’en raison de son excès. En effet, l’empirisme et le scepticisme qui finissent dans le psychologisme et méprisent la raison authentique n’ont pour lui de philosophique que le nom. Ce type de subjectivisme est tout aussi outrancier que l’objectivisme. Kant théorise cette tendance en érigeant ce qu’on pourrait appeler un « tribunal de la raison » qui sépare d’une part les connaissances que l’on peut avoir de façon certaine et le reste qui ne peut être que pensé. Son sujet transcendantal est un pur sujet de connaissance ; le positivisme ne fera que confirmer cette propension à l’objectivisme.
Aussi, Husserl cherche-t-il à justifier la tâche infinie de la raison guidée par son entéléchie en proposant une réunification de la philosophie. Il s'agit pour lui de réunir à nouveau objectivité et subjectivité. C'est ce qu'il se propose de faire avec la phénoménologie transcendantale. Or, une pure subjectivité est vide comme l’a montré Kant à propos de Descartes. A la suite de son maître Brentano, Husserl insiste donc sur le fait que « toute conscience est conscience de quelque chose » puis développe le concept d’intentionnalité. Il s’agit d’une corrélation entre le sujet et l’objet : à partir de l’ego transcendantal, s'effectue entre ces deux pôles un mouvement de va-et-vient.
Mais que s'ensuit-il ? Paradoxalement et comme l'a bien montré un Cavaillès notamment, le sujet donne son être total à l’objet.
06:45 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/03/2005
Orbis Tertius Resartus
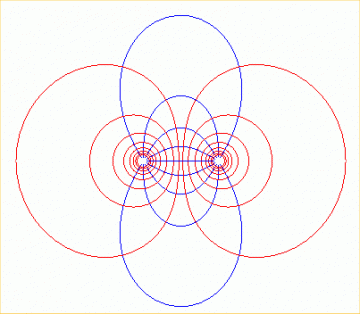
On pourra définir les différents centres de perspective d’une époque déterminée par les forces qui l’ont créée et ceux qu’elle prépare grâce à l’analyse des interactions mêmes entre ces centres de perspective. La juxtaposition de ceux-ci devra rendre visibles, outre la vision du monde correspondante (Weltanschauung), les éléments moteurs qui la composent afin de repérer la dynamique du devenir qui prépare la métamorphose synthétique.
Lors de cette investigation, les différents domaines à étudier seront d’abord les ponts anthropologiques, économiques, institutionnels et théologiques, puis la perception sous-tendue du monde, ou mieux la mythologie implicite où se tiennent ramassées la religion et la perception de la philosophie.
La genèse de ces "moments" ne pourra évidemment se faire sans la prise en compte des réalités telles que les flux de marchandises, les contacts entre les différentes cultures (langues, coutumes, sciences, techniques etc.) et les diverses espèces biologiques, c'est-à-dire, en amont, sans l'analyse des structures géomorphologiques et biosphériques qui conditionnent en dernière instance les bases de la civilisation en question, civilisation qui produit elle-même en retour une symbolique des éléments synthétisant les relations réciproques grâce à l’incarnation propre au symbole.
La mise au jour des différents centres de perspective inclus dans une dynamique des flux du devenir permettra l’évacuation de la question du Sujet-Substance au sein de la méthode, et l’on pourra ainsi dégager objectivement des réseaux dont le nexus, nos propres centres d’interprétation, c'est-à-dire les articulations encyclopédiques, qui, on le voit, doivent être l’Esthétique et l’Ethique.
Ainsi, par l’étude de ces boucles de relations, pourra-t-on dégager une batterie de correspondances purement mathématiques entre le milieu et la mytho-cosmo-logie, c’est-à-dire entre la perception du milieu et ce qu’il doit être, laissant apparaître dans l’entre-deux, comme corollaire mineur, la dynamique et la condition propre de l’homme. En effet, se dégageront tout naturellement l'intégralité des modes d'existence possibles, et la fréquence de leur répétition, « illimitée et périodique ».
Gunnar Erfjord, bien que précurseur, était finalement trop borné et, impardonnablement, dédaigneux de la combinatoire.
01:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
27/03/2005
Palindrome

Debord, in girum imus nocte et consumimur igni :
« Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet ceux-ci se trompent sur tout, et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits, et des morts qui croient voter.
Comme le mode de production les a durement traités ! De progrès en promotions, ils ont perdu le peu qu'ils avaient, et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé ; ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse, et à l'étroit, dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres ; mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût ; mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées ; continuellement et mesquinement surveillés ; entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leurs provinces ou de leurs quartiers, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles.
Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire : "il faut", et ils veulent bien le croire. Mais surtout on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment ; et aussi bien le contraire le lendemain.
Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits, perte qui leur interdit le moindre dialogue ; séparés par leur incessante concurrence, toujours pressée par le fouet, dans la consommation ostentatoire du néant, et donc séparés par l'envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leur propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui n'ont rien. On leur enlève, en bas âge, le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n'écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents, et sourient de leur échec flagrant ; méprisent non sans raison leur origine, et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ses domestiques qui les ont par hasard engendrés : ils se rêvent les métis de ces nègres-là. Derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n'échange que des regards de haine. »
00:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
25/03/2005
Holzweg platonique
« Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est à ce moment : lorsque l'humain contemple la Beauté en soi. Si tu y arrives, l'or, la parure, les beaux jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui, tout cela te semblera terne. Songe au bonheur de celui qui voit le Beau lui-même, simple, pur, sans mélange, plutôt que la beauté chargée de chairs, de couleurs et de cent autres artifices périssables... »

Il peut être utile de compléter la lecture du Banquet par celle du Phèdre. On reste néanmoins dubitatif et Alcibiade insatisfait. N'y a-t-il pas chez Platon une subreption, une étrange inversion ? Que peut être une métaphysique qui justifie finalement une telle abstention des sens ?
L'objet du désir ne peut être un objet. Certes. Mais qui peut bien concevoir selon le schème de l'objet un corps animé si ce n'est un maniaco-dépressif oscillant entre l'envol ivre vers l'Idée et la chute catatonique dans le chaos ?
Alors est-ce vraiment une bêtise de citer ce qui est beau lorsqu'on demande ce qu'est le beau ? Ou bien est-ce plutôt dans la question "qu'est-ce que ?" elle-même que réside ladite bêtise ? En effet, la question alternative "qui ?" posée par le sophiste Hippias a au moins le mérite de conduire à pénétrer directement l'essence réelle au lieu de la perdre dans les marais nihilistes de l'aporie.
22:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
24/03/2005
Gödelisme

Gödel, « le plus grand logicien depuis Aristote » d'après Von Neumann, naquit en 1906 à Brno. Il mourut à Princeton en 1978 obsédé par des idées délirantes en rapport avec de perverses et pléthoriques attaques microbiennes. Quelques années avant son décès, on pouvait d'ailleurs l'observer, mutique et buvant de l'eau chaude pure, dans le hall de l'Institute for Advanced Studies de Princeton dont il contribua à faire la gloire.
C'est en 1931 que Gödel publia son article magistral intitulé Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Le problème qui y est traité relève des fondements des mathématiques.
Le théorème de Gödel de 1931 comprend en effet deux résultats, ou deux formes d’incomplétude :
1. Dans tout système formel consistant contenant une théorie des nombres finitaires relativement développée, il existe des propositions indécidables, id est, si T est consistante, il y a un énoncé vrai mais non démontrable dans T.
2. La consistance d’un tel système ne saurait être démontrée à l’intérieur de ce système, id est si T est consistante, alors l'énoncé universel qui énonce la consistance de T n'est pas démontrable dans T.
On assiste ici à la réfutation de programme de Hilbert qui promouvait une doctrine formaliste des mathématiques. Il s'agissait de démontrer la non contradiction des mathématiques abstraites dans les mathématiques finitaires, donc décidables de manière élémentaire.
L'innovation de Gödel consiste principalement dans la distinction entre vérité et prouvabilité. Il existe des énoncés qui sont vrais sans être démontrables. Ce qui implique le deuxième volet du théorème qui ruine le rêve hilbertien de fondation des mathématiques ex nihilo par elles-mêmes, à l'aide de leurs seules ressources.
On ne peut internaliser la vérité ; il existe des limitations à la réflexion d'une théorie à l'intérieur d'elle-même. Voilà ce qu'énonce et démontre Gödel. Il n'est cependant point besoin d'avoir recours au pamphlet de Sokal et Bricmont pour parler de dérives "gödelistes". En effet, si l'on omet la question de la démonstration de consistance absolue d'une théorie, celle-ci peut, pour le reste, se penser parfaitement elle-même. Gödel ne détruit pas les mathématiques : il ne fait que limiter les métamathématiques et les guérir de leur autistique syndrome de Munchausen. De même, inférer que les résultats de Gödel puissent se généraliser à la pensée ou à l'univers, revient à considérer a priori et arbitrairement ces entités comme algorithmiquement décidables, c'est-à-dire équivaut à les rendre ontologiquement justiciables du mécanisme comme doctrine.
Ainsi, dans leur aveuglement, les essayistes qui donnent au théorème de Gödel une ampleur cosmique ne font-ils que prendre paradoxalement le parti de leurs adversaires. A tout prendre, c'est un certain type de dogmatisme que, finalement, Gödel réfute, et rien d'autre.
22:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/03/2005
Pudenda origo

Chez Hegel, il est clair que la répression est une composante fondamentale de la civilisation en tant que telle. Notons : pas l'oppression. Le maître qui éduque et fait de moi un être civilisé n'est pas despotique. Il s'avère être bien plutôt le type même du dresseur subtil, le tyran à la manière grecque, un Pisistrate contraignant les Athéniens à vivre selon les lois de Solon. Ce n'est que l'apprentissage de l'Universel, de la "liberté" en somme. Puis, la crainte et les tremblements, trop voyants, disparaissent dans l'obéissance :
« Grâce à la tyrannie est obtenue l'aliénation immédiate de la volonté singulière effective - cette formation à l'obéissance. Du fait de celle-ci, qui [nous apprend] à connaître l'Universel plutôt que les volontés réelles, la tyrannie est devenue superflue, le règne de la Loi est advenu. Le pouvoir qu'exerce le tyran est le pouvoir de la Loi en soi ; grâce à l'obéissance, ce n'est plus un pouvoir étranger, mais la volonté connue comme universel. On dit que la tyrannie est renversée par les peuples parce qu'elle serait exécrable, infâme, etc. En réalité, c'est tout simplement parce qu'elle est superflue. » (Hegel, Realphilosophie).
Le pouvoir despotique a le tort de ne pas laisser oublier à celui qui le subit la violence qui lui est faite. Hegel donc, lui reproche non d'user de violence mais la nécessité dans laquelle il se trouve d'avoir à l'exercer continûment. Au moindre fléchissement de la puissance de ce joug surgit sans coup férir la revendication libertaire. Que faire ? C'est tout le sel de la naissance de l'Etat. Son secret consiste à pousser la répression jusqu'au point où, au sein de l'esprit des sujets, toute idée de résistance devienne inconcevable. Ce qui se dit aussi : devenir raisonnable. Ce projet, pour devenir réalité, nécessita néanmoins une débauche de créativité. De cette spiritualisation, on pourra en savoir gré, par exemple, à un Caligula qui, a-t-on dit, prostituait les épouses des sénateurs pour renflouer les caisses de l'Etat.
Ainsi « la toute-puissance de l'empereur efface[-t-elle] les différences entre les hommes libres et les esclaves. » Enfin l'homme en tant qu'homme devient un concept pensable ! « La subjectivité, qui a saisi sa valeur infinie, a renoncé par là à toutes les différences qui tiennent à la souveraineté, au pouvoir, à la classe et même au sexe : devant tous les dieux, tous les hommes sont égaux. » (Ph. Rel., XVI).
Ô fantastique Bildung ! Que la Raison de Hegel vogue et ruse au gré de son histoire. Celle-ci n'est jamais que celle des raisons que les sujets se firent pour rendre leur servitude tolérable.
20:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
20/03/2005
Procès d'aliénation

Althusser, Lénine et la philosophie suivi de Marx et Lénine devant Hegel, Maspéro, Paris, 1972 :
« Le seul sujet du procès d’aliénation c’est le procès lui-même dans sa téléologie. Le sujet du procès ce n’est même pas la fin du procès lui-même [...] c’est le procès d’aliénation en tant que poursuivant sa fin, donc le procès d’aliénation lui-même en tant que téléologique. Téléologie que n’est donc plus une détermination qui s’ajoute du dehors au procès d’aliénation sans sujet. La téléologie du procès d’aliénation est inscrite en toutes lettres dans sa définition, dans le concept d’aliénation, qui est la téléologie même dans le procès [...] l’origine, indispensable à la nature téléologique du procès (puisqu’elle n’est que la réflexion de sa fin), doit être niée dès l’instant où elle est affirmée, pour que le procès d’aliénation soit un procès sans sujet [...] cette exigence implacable (affirmer et en même temps nier l’origine) Hegel l’a assurée de manière consciente dans sa théorie du commencement de la Logique ; l’Être est immédiatement non Être, le commencement de la Logique est la théorie de la nature non originante de l’origine. La logique de Hegel est l’Origine affirmée-niée : première forme d’un concept que Derrida a introduit dans la réflexion philosophique, la rature. »
20:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
Histoire de masque

L’analyse de la philosophie de Descartes à laquelle se livre Spinoza dans les Principes de la Philosophie de Descartes se veut fidèle. La préface de Louis Meyer le souligne expressément : « Ayant promis d’enseigner à son élève la philosophie de Descartes, il se fit une religion de ne pas s’en écarter d’un pouce ». C’est Spinoza qui demanda à Meyer d’insister sur le caractère purement cartésien de l’ouvrage. Mais en même temps « il avertirait les lecteurs par un ou deux exemples que loin d’en reconnaître tout le contenu, j’étais sur de nombreux points d’une opinion tout opposée ». De fait, Louis Meyer écrit : « Que nul ne croie que l’auteur enseigne ici ses propres idées ou même celles qu’il approuve », car, par exemple : « l’auteur ne croit pas difficile de démontrer que la volonté n’est pas distincte de l’entendement, et qu’il est encore moins question qu’elle jouisse de la liberté que Descartes lui attribue » . On reconnaît ici l’un des thèmes majeurs de l’Ethique en même temps que l’une de ses critiques les plus célèbres contre Descartes.
Il est donc clair que Spinoza n’a jamais été un cartésien, du moins pas un cartésien orthodoxe (car la préface déclare : « encore qu’il en estime certaines [idées] valables » ). Qu’il possédât une philosophie distincte de celle de Descartes est également attesté par la Lettre IX (à Simon de Vries) dans laquelle il écrit : « Vous n’avez pas de raison de porter envie à Casearius [l'élève de Spinoza] ; nul être ne m’est plus à charge et il n’est personne de qui je me garde autant […] il ne faut pas lui communiquer mes opinions. » D’ailleurs le Tractatus de Intellectus Emendatione, écrit dès avant 1661 (comme il est permis de le conjecturer d’après la Lettre VI à Oldenburg non datée), montre des positions clairement non cartésiennes.
Pourquoi alors Spinoza publie-t-il l’ouvrage ? Quels sont ses motifs ? La publication d’un commentaire sur Descartes, dans les Provinces-Unies de la seconde moitié du XVIIème siècle n’était pas un acte neutre. Il avait une importance à la fois philosophique et politique ; plus exactement, il avait une importance philosophique parce qu’elle était politique. Ce qui se jouait autour de la pensée cartésienne, c’était la liberté de philosopher face aux instances théologiques. Mais ce n’est pas pour cela que le cartésianisme incarnait cette liberté. Dans cette affaire, le cartésianisme est pour Spinoza comme une cause occasionnelle. La Lettre XIII (à Oldenburg) confirme cette hypothèse : « De la sorte, peut-être quelques personnes d’un rang élevé se trouveront-elles dans ma patrie qui voudront voir mes autres écrits où je parle en mon propre nom, et feront-elles que je puisse les publier sans aucun risque. Dans ce cas je ne tarderai guère sans doute à faire paraître quelque chose ; s’il en est autrement, je garderai le silence plutôt que de me rendre odieux à mes concitoyens en leur imposant, contre leur gré, la connaissance de mes opinions. »
Spinoza cherche encore des alliés et utilise à cette fin la pensée cartésienne qui est le signe de ralliement pour ceux (et notamment certains politiques comme les frères de Witt) qui accueillent la nouvelle science et d’une manière générale ceux qui rejettent les préjugés théologiques, « vestiges d’une ancienne servitude ».
Larvatus prodeo. Sur ce point du moins, Spinoza aura d'abord été cartésien.
16:40 | Lien permanent | Commentaires (0)
18/03/2005
Unien

L’ennui vient ; il vient du néant programmé de toutes choses. Alors, le temps gèle et sa ligne ne revèle plus que les infinies variations du Même.
Mieux vaut sans doute divaguer que de se concentrer sur le rien. Car la fatale et suprême tentation serait la fascination du vide de la plénitude de l'être.
En effet, absurdement, le plérome de l'être avère sa néantité. Si le "réel est l'impossible", que l'être soit est ce déchirement où la logique défaille. Penser le non-être de l'être est le néant d'une pensée tendue et diffractée qui s'efforce de penser la mort qui est l'absence de toute pensée.
Le Même ne cesse d'insister sous la surface des subtiles myriades travesties du Multiple. Mais l'Un, toujours, se retire. Il s'absente sous l'épiphanie de ses substituts inépuisables. A éluder le désir, il est plus tragiquement présent dans son absence.
Oui, Néant est l'Un. Néanmoins, cette (non-)pensée suffit à l'amener à l'existence.
06:45 | Lien permanent | Commentaires (0)
16/03/2005
Eléments de 'Pataphysique

Jarry, Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Livre Deuxième, Eléments de Pataphysique, "VIII. Définition" (1898) :
Un épiphénomène est ce qui se surajoute à un phénomène.
La pataphysique dont l’éthymologie doit s’écrire επι (μετα τα φυσιχα) et l’orthographe réelle ‘pataphysique, précédé d’un apostrophe, afin d’éviter un facile calembour, est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-delà de la physique. Ex. : l’épiphénomène étant souvent l’accident, la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers supplémentaire à celui-ci ; ou moins ambitieusement décrira un univers que l’on peut voir et que peut-être l’on doit voir à la place du traditionnel, les lois que l’on a cru découvrir de l’univers traditionnel étant des corrélations d’exceptions aussi, quoique plus fréquentes, en tous cas de faits accidentels qui, se réduisant à des exceptions peu exceptionnelles, n’ont même pas l’attrait de la singularité.
DÉFINITION. - La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
La science actuelle se fonde sur le principe de l’induction : la plupart des hommes ont vu le plus souvent tel phénomène précéder ou suivre tel autre, et en concluent qu’il en sera toujours ainsi. D’abord ceci n’est exact que le plus souvent, dépend d’un point de vue, et est codifié selon la commodité, et encore ! Au lieu d’énoncer la loi de la chute des corps vers un centre, que ne préfère-t-on celle de l’ascension du vide vers une périphérie, le vide étant pris pour unité de non-densité, hypothèse beaucoup moins arbitraire que le choix de l’unité concrète de densité positive eau ?
Car ce corps même est un postulat et un point de vue des sens de la foule, et pour que sinon sa nature au moins ses qualités ne varient pas trop, il est nécessaire de postuler que la taille des hommes restera toujours sensiblement constante et mutuellement égale. Le consentement universel est déjà un préjugé bien miraculeux et incompréhensible. Pourquoi chacun affirme-t-il que la forme d’une montre est ronde, ce qui est manifestement faux, puisqu’on lui voit de profil une figure rectangulaire étroite, elliptique de trois quarts, et pourquoi diable n’a-t-on noté sa forme qu’au moment où l’on regarde l’heure ? Peut-être sous le prétexte de l’utile. Mais le même enfant, qui dessine la montre ronde, dessine aussi la maison carrée, selon la façade, et cela évidemment sans aucune raison ; car il est rare, sinon dans la campagne, qu’il voie un édifice isolé, et dans une rue même les façades apparaissent selon des trapèzes très obliques.
Il faut donc bien nécessairement admettre que la foule (en comptant les petits enfants et les femmes) est trop grossière pour comprendre les figures elliptiques, et que ses membres s’accordent dans le consentement dit universel parce qu’ils ne perçoivent que les courbes à un seul foyer, étant plus facile de coïncider en un seul point qu’en deux. Ils communiquent et s’équilibrent par le bord de leur ventre tangentiellement. Or même la foule a appris que l’univers vrai était fait d’ellipses, et les bourgeois mêmes conservent leur vin dans des tonneaux et non des cylindres.
Pour ne point abandonner en digressant notre exemple usuel de l’eau, méditons à son sujet ce qu’en cette phrase l’âme de la foule dit irrévérencieusement des adeptes de la science pataphysique :
17:35 | Lien permanent | Commentaires (0)
14/03/2005
Ludions

Il est remarquable que Descartes déclare qu'aucune vérité philosophique ne peut être incompatible avec la vérité des dogmes révélés. Il dit soutenir la « cause de Dieu » et affirme l'obligation qu'a un chrétien d'employer la raison pour lutter contre les négations des libertins. De plus, les Méditations Métaphysiques recherchent ostensiblement l'approbation des théologiens. La métaphysique cartésienne serait-elle "stratégique"? : « Je vous dirai entre nous, que ces six méditations contiennent tous les fondements de ma physique, mais il ne faut pas le dire » écrit Descartes à Mersenne.
Quoi qu'il en soit, comme le dit Gueroult, chez Descartes, Dieu est certes l'objet de la plus claire et de la plus distincte des idées, mais cette idée nous la fait connaître comme incompréhensible.
Spinoza, quant à lui, empruntant à cette occasion la voix de Louis Meyer (préface des Principes de la Philosophie de Descartes), refuse de s'associer à cette affirmation du cartésianisme que « telle ou telle chose est au-dessus de l'humaine compréhension. » En effet, lit-on dans la préface du Traité théologico-politique, « le grand secret du régime monarchique et son intérêt profond consistent à tromper les hommes, en travestissant du nom de religion la crainte dont on veut les tenir en bride, de sorte qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. »
Une telle audace, corrélative de son exigence d'intelligibilité absolue, lui permet de découvrir un territoire inconnu.
Philosophe sans Cogito, Spinoza se contente de cette affirmation liminaire : « l'homme pense ». Mais il démontre ensuite que la conscience psychologique se révèle être le site d'une illusion contre laquelle le Cogito ne peut nous prémunir. Essentiellement, elle nous coupe des causes et ne perçoit que des effets. C'est ce tropisme structurel qui explique que la conscience s'érige en cause première et, en conséquence, croit étendre son empire sur le corps. « C'est ainsi qu'un petit enfant croit désirer librement le lait, un jeune garçon en colère vouloir la vengeance, un peureux la fuite. Un homme en état d'ébriété aussi croit dire par un libre décret de l'âme ce que, sorti de cet état, il voudrait avoir tu. » (Ethique, III, 2, scolie). De là suit logiquement la fiction d'un Dieu à l'image de l'homme tel qu'il se conçoit, c'est-à-dire doté notamment d'entendement et de volonté. « Si le triangle parlait, il dirait que Dieu est éminemment triangulaire » (lettre LVI à Boxel) « [...] car ceux qui ignorent les vraies causes des choses confondent tout, et c’est sans aucune répugnance d’esprit qu’ils forgent des arbres parlant tout autant que des hommes, et des hommes formés de pierres tout autant que de la semence, et imaginent que n’importe quelles formes se changent en n’importe quelles autres. De même aussi ceux qui confondent la nature divine avec l’humaine attribuent aisément à Dieu des affects humains, surtout aussi longtemps qu’ils ignorent aussi comment les affects se produisent dans l’esprit. » (Ethique, I, Prop. VIII, sc. II)
De fait, la théologie maintient la conscience psychologique dans ses illusions anthropomorphiques en donnant à Dieu des prédicats anthropologiques et en faisant de l'homme « un empire dans un empire ». Spinoza propose donc de mettre le corps au premier plan ainsi qu'une théorie de l'affectivité apte à rendre compte de la conscience et de ses illusions. Pour Spinoza, ce n'est ni l'entendement ni la volonté qui définissent l'homme. Leur scission n'a d'ailleurs pas de sens puisque cela reviendrait à s'imaginer nos pensées comme des « tableaux ». C'est en réalité d'une unique instance qu'il s'agit : la vraie nature de la pensée n'est pas représentative.
Au contraire : « le désir est l'essence même de l'homme ». C'est pourquoi la théorie spinoziste de l'affectivité met l'accent sur ce constat : la pensée est plus vaste que la conscience et ses représentations. « Comme s'il s'agissait de lignes, de plans ou de corps », Spinoza exhibe donc la logique des passions et, en creux, le fonctionnement de l'inconscient. En effet, bien que ce terme ne soit jamais employé comme substantif, le champ lexical qui lui correspond est souvent présent dans les scolies et démonstrations cruciales de l'Ethique.
Même si les hommes sont ignorants des causes qui les déterminent, il n'en reste donc pas moins que des parties de l'âme sont déterminées par des causes extérieures : il y a des raisons qui nous structurent à notre insu.
« D’où il appert que les causes extérieures nous agitent de bien des manières, et que, comme les eaux de la mer agitées par des vents contraires, nous sommes ballottés, inconscients de notre sort et de notre destin. » (Ethique, III, P LIX, scolie)
18:40 | Lien permanent | Commentaires (0)
12/03/2005
La résolution de Chestov

« C’est la philosophie qui cèdera, il suffira de ne pas se rendre intérieurement : c’est ainsi que les Napoléon viennent à la philosophie et c’est ainsi qu’ils la comprennent. Et jusqu’à preuve du contraire rien ne peut nous empêcher de penser que les Napoléon ont raison et que, par conséquent, la philosophie académique n’est pas le dernier ni même l’avant-dernier mot. Car, le dernier mot, peut-être que ce sont les gens qui ne savent pas parler mais qui sont audacieux, persévérants et irréductibles qui le gardent par-devers eux. » (Chestov, Les commencements et les fins)
A la lecture de ce fragment, d'aucuns pourraient être surpris de la profonde admiration que Husserl, le dernier des philosophes classiques, vouait à Chestov qui, à son tour, avait un grand respect pour l'auteur des Méditations cartésiennes. Une telle estime intellectuelle entre deux esprits si éloignés sur l'échiquier philosophique est rare et précieuse. Animée par la bonne Eris, elle est parente du regard franc, direct et altier que peuvent échanger, à l'occasion d'un hasard géomorphologique, deux alpinistes acharnés, chacun dédié à l'ascension d'une face différente d'un même pic escarpé.
12:45 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/03/2005
L'éclair du Tout

Il est notoire que le différend entre les philosophies de Deleuze et de Badiou repose essentiellement sur leur articulation respective des concepts de tout et d'ensemble. Au moins est-ce l'angle de l'attaque ambiguë et post mortem de Badiou, replié dans la citadelle de la théorie mathématique des ensembles. Une brève note de Qu'est-ce que la philosophie ? consacrée à l'Être et l'événement semble tout de même l'y autoriser.
Une première approche pourrait consister à cerner la manière dont Deleuze traite ce couple conceptuel et à en établir le motif. Interroger un passage de l'Image-Mouvement (pp. 20-22), où Deleuze commente Bergson, est, à cet égard, pertinent.
Deleuze s'y emploie à définir le "tout" d’une manière plus empiriste que kantienne. En effet, Kant fait de la totalité une catégorie de l’entendement (sous la rubrique de la quantité) et la présente comme synthèse de l’unité et de la pluralité. Il s’agit là d’un principe de clôture car la synthèse clôt la pluralité, c’est-à-dire qu’elle en fait un tout par la médiation de l’unité. Au contraire, à la suite de Hume, Deleuze, définit le "tout […] par la Relation". Il ajoute que la relation "n’est pas une propriété des objets". En effet, soient par exemple deux nombres x et y. Le fait que x < y n’est pas une propriété de x ou de y mais une propriété de la relation d’ordre qui n’est pas liée à x et y. C’est donc parce qu’elle n’est pas une propriété des objets que la relation est "extérieure à ses termes". Si la relation n’est pas une propriété des objets, à quoi appartient-elle ? Selon Deleuze, elle appartient au tout. Mais il convient de concevoir le "tout" d’une manière spéciale. On a vu que la totalité de type kantien se caractérisait par un principe de clôture tandis que le tout, pour Deleuze commentant Bergson, se définit en rapport à l’Ouvert. En revanche, c’est un apport deleuzien que de définir le "tout" par la Relation: "Nous faisons intervenir ici le problème des relations, bien qu’il ne soit pas explicitement posé par Bergson." En distinguant le tout d’un "ensemble fermé d’objets", il devient possible d’attribuer les relations au tout. En effet, si l’on ne peut attribuer les relations aux objets, l’on ne peut pas non plus les attribuer à l’ensemble. C’est la fermeture, la clôture qui caractérise l’ensemble qui interdit que l’on puisse lui attribuer la relation. Il est donc nécessaire de définir le tout par la non clôture, par l’Ouvert, en même temps que par la relation pour être en mesure de distinguer le concept de tout de celui d’ensemble. On sait en effet que, pour Bergson, le continu est un attribut de la durée et donc de la conscience. Or, contrairement à l’ensemble, le tout a un caractère "continu", ce qui, outre le fait de lui autoriser l’attribution des relations, lui confère donc également ce que Deleuze nomme une "existence spirituelle ou mentale".
A ce stade de la démonstration, on peut remarquer que les notions de "tout" et d’"ensemble", ainsi distinguées, peuvent s’appliquer à deux domaines distincts ; celui de la quantité d’une part, et de la qualité d’autre part. En effet, quant à la quantité, le concept d’ensemble caractérise les objets dont les "positions" sont dites "respectives" car l’ensemble est fermé. Or, c’est dans l’espace que les objets ont des positions. Mais ce n’est que par le mouvement que celles-ci peuvent permuter. Néanmoins ce "mouvement dans l’espace" relève de la quantité discrète. Au contraire, quant à qualité, à la transformation qualitative, c’est la "durée même" qui est à l’oeuvre. Et comme, d’une part, c’est par elle que le tout "change de qualité", et que, d’autre part, le tout se définit "par la Relation", la "durée" peut être dite par Deleuze "le tout des relations".
Paradoxalement, le tout n’est pas ici défini comme ayant des parties ; cette définition est en effet réservée aux ensembles : "Les ensembles sont toujours des ensembles de parties". Au contraire, selon une citation de Bergson : "Le tout réel pourrait bien être une continuité indivisible" (L'énergie créatrice, p.520 (31)). Il serait contradictoire qu’une continuité ait des parties, car une continuité divisée n’est, par définition, plus continue. C’est pourquoi Deleuze réserve le terme de "parties " au sens strict aux ensembles et affirme que le tout ne peut être dit avoir des parties qu’ "en un sens très spécial". En effet, la division du tout ne le fractionne pas en parties mais le fait "changer de nature à chaque étape de la division". Ainsi est-il question d’une multiplicité intensive et donc d’une indiscernabilité entre le "tout" et les "touts". Deleuze indique cette indiscernabilité par l’emploi de l’apposition "le tout, les ‘touts’" lorsqu’il affirme qu’"on ne doit pas confondre le tout, les ‘touts’, avec des ensembles". Bien qu’indiscernables "tout" et "touts" sont distincts. Il convient donc de les mettre en parallèle non pas avec un unique ensemble mais avec des "ensembles". Deleuze dit expressément que "le tout n’est pas un ensemble clos". Or, de même, les "ensembles sont clos". On peut en inférer immédiatement que les "touts" ne sont pas des ensembles clos. On peut donc affirmer que "le tout, les ’touts’" ne sont ni un ensemble clos ni des ensembles clos. De plus, le strict équivalent de "le tout, les ‘touts’" est "un tout" car le "un" désigne en effet un tout quelconque et donc à la fois les "touts", distributivement et collectivement, c’est-à-dire le tout. Or, "un tout n’est pas clos, il est ouvert". Il s’ensuit donc que le tout (ou les ‘touts’, ou "un tout") est "ouvert" et donc n’est pas un ensemble. En outre, n’étant n’est ni un ni plusieurs ensembles, le tout n’est ni un ni multiple. Le tout est donc une multiplicité ouverte. Par conséquent, Deleuze peut, logiquement, en conclure, affinant ainsi la distinction entre tout et ensemble, et plus précisément, en définissant, cette fois, le tout par rapport à l’ensemble, que "le tout […] est […] ce par quoi l’ensemble n’est jamais absolument clos, jamais complètement à l’abri, ce qui le maintient ouvert quelque part". C’est pourquoi Deleuze affirmait que, si un ensemble est clos, il l’est "artificiellement". Ainsi, le tout, défini par l’ouvert et la relation, est-il un lien, un "fil ténu", qui ouvre l’ensemble "au reste de l’univers". Si l’ensemble était absolument clos, on ne pourrait pas comprendre, dans l’exemple de Bergson, le processus de dissolution du sucre dans le verre d’eau. En tant qu’ensemble clos, il a des parties ("l’eau, le sucre, peut-être la cuiller"), mais c’est en tant que tout qu’il change, et donc que le sucre peut fondre. La dissolution en tant que changement qualitatif ininterrompu ("le pur devenir sans arrêt") relève du tout et non de l’ensemble, c’est-à-dire qu’elle se déroule dans "une autre dimension", que celle, quantitative, de l’ensemble. Or Bergson déclare que "le Tout […] progresse peut-être à la manière d’une conscience" (EC, p. 502-503 (10-11)) ; c’est pourquoi Deleuze peut dire que "c’est en ce sens qu’il est spirituel ou mental". Si "tout ce qui est clos est artificiellement clos", la détermination d’un ensemble, sa clôture, n’est pas pourtant purement arbitraire. Elle est certes une "abstraction" mais celle-ci est légitime car opérée par "mes sens et mon entendement." Mais fermer un ensemble, opérer son découpage, est une opération qui, même si elle n’est que relative, peut néanmoins être poussée indéfiniment, sans atteindre à un terme dernier. Si c’était le cas, l’ensemble n’aurait en effet plus de lien au tout, c’est-à-dire qu’il serait impossible de le mettre en relation avec un autre ensemble, à commencer par lui-même. C’est-à-dire qu’il serait purement et simplement impensable. Ce serait une contradiction puisque l’ensemble peut être défini de manière conceptuelle. Ainsi, Deleuze peut-il affirmer plus généralement que même si "le lien de chaque chose avec le tout est impossible à rompre […] il peut du moins être […] rendu de plus en plus ténu."
Après avoir davantage précisé la distinction entre le concept de tout et celui d’ensemble, Deleuze en arrive à la dernière étape de sa démonstration. En effet, les ensembles sont clos contrairement au tout qui est relation à l’ouvert. Or le tout est "spirituel ou mental". Donc, les ensembles en tant que clos, renvoient non à la conscience mais à la matière. Plus précisément, les ensemble clos, composés de parties, se rapportent à l’organisation de la matière conçue comme partes extra partes.
Ainsi, c’est "le déploiement de l’espace qui les [ensembles déterminés de parties] rend nécessaires." Le tout en tant qu’ouverture des ensembles, et les faisant changer, c’est-à-dire passer par différents états qualitatifs, les fait durer. Le "tout, les touts" sont donc ce qui relie les ensembles (avec eux-mêmes et avec les autres) dans la durée. Or, on a vu que le tout et les touts sont distincts et indiscernables ; donc ils "sont la durée même qui ne cesse pas de changer".
Nous sommes maintenant à même de saisir la pertinence de l’analyse deleuzienne du couple conceptuel tout / ensemble. Cette distinction permet en effet de distinguer absolument les concepts d’espace et de durée. Les parties des ensembles ne sont mobiles que parce qu’ils sont reliés au tout. C’est le tout ouvert qui explique le mouvement réel. Sans le tout, il n’y aurait pas de mouvement réel, mais seulement des coupes immobiles. On ne donnerait l’illusion du mouvement qu’à établir une succession, spatiale par définition, de telles coupes ; on joindrait aux "coupes immobiles" un temps abstrait. La durée concrète au contraire a pour principe même le mouvement réel, puisqu’elle est la relation même, c’est-à-dire la mise en relation par le tout, ce "lien paradoxal".
Le mouvement réel est donc celui du tout comme ouvert qui anime les systèmes clos, coupes immobiles, et qui fait ainsi étinceler des "coupes mobiles".
21:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
08/03/2005
Un vertige

A partir de différents documents ou témoignages, il est, par exemple, possible de procéder à cette estimation :
Chrysippe a écrit 705 traités soit l'équivalent de 700 lignes quotidiennes.
Origène composa 2000 ouvrages.
A la Bibliothèque de Hanovre, se trouvent 200 000 pages manuscrites de Leibniz qui écrivit 16 000 lettres.
Voltaire, quant à lui, en composa plus de 18 000.
Le logicien et philosophe américain Peirce atteignit l'honorable moyenne de 2 000 mots par jour.
En ce qui concerne Husserl, on compte 30 volumes publiés tandis que 45 000 pages restent inédites.
Un tel exercice comptable peut certes paraître futile. Il n'en demeure pas moins qu'à l'instar de certains espaces, ces chiffres sont effrayants voire doublement vertigineux.
07:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/03/2005
Le paradoxe du Tractatus

D'abord publié en 1921 dans la revue Annalen der Naturphilosophie, le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein paraît ensuite en Angleterre avec sa traduction anglaise et la préface de Russell.
Cet ouvrage fait montre d'un positivisme logique extrême. Il prend sa source dans la nouvelle logique construite par Frege (1858-1925) puis par Russell et Whitehead (Principia Mathematica, 1910-1913). Le Tractatus inspirera d'ailleurs les travaux ultérieurs du Wiener Kreis (Schlick, Waismann, Carnap, Neurath, Feigl, etc.) dont la postérité est innombrable.
Un fait est pour Wittgenstein une relation entre des objets représentés par des noms dans une proposition. En effet, si le "monde est tout ce qui a lieu" (1), "le monde est la totalité des faits, non des choses." (1.1) Or, "La pensée est la proposition pourvue de sens" (3) et "l'image logique des faits est la pensée" (4). On peut donc parler ici de parallélisme logico-physique : "A la configurations des signes simples dans le signe propositionnel correspond la configuration des objets dans la situation." (3.21) De plus : "La proposition est une image d'une situation dans la mesure seulement où elle est logiquement segmentée." (4.032). Il y a donc similarité de structure entre la pensée et les faits qu'elle représente.
Il est donc manifeste que le sens d'une proposition s'avère être la représentation d'un état de chose : "On peut directement dire, au lieu de : cette proposition a tel ou tel sens, cette proposition figure telle ou telle situation." (4.031) Wittgenstein tente, grâce à l'examen de la forme logique des propositions, non de délimiter le domaine du vrai, mais celui du sensé. En effet, une proposition est douée de sens non quand elle est vraie mais lorsqu'elle est susceptible d'être vérifiée.
Pour avoir un sens, la proposition doit donc satisfaire aux critères logiques, c'est-à-dire avoir une forme logique. Ainsi, toute proposition sensée détermine-t-elle un fait possible : "Le sens de la proposition est son accord ou son désaccord avec les possibilités de subsistance ou de non-subsistance des états de choses." (4.2)
Dans cette optique, il apparaît alors que "la plupart des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens. Nous ne pouvons donc en aucune façon répondre à telles questions, mais seulement établir leur non-sens." (4.003) Les concepts tels que l'Être ou le sujet dont le discours philosophique s'empare seraient donc les symptômes d'un langage non maîtrisé multipliant sans retenue des entités fictives. Wittgenstein est un nouvel Occam.
Où, exactement, pèche la philosophie traditionnelle ? La réponse est nette : elle outrepasse la fonction représentative du langage en cherchant à représenter ce qu'il est impossible de représenter. Il s'agit, au contraire, de se contenter d'exhiber la communauté de forme entre la syntaxe logique de la proposition sensée et celle des faits réels que celle-ci représente. En ce sens, les constantes logiques ("et", "ou", etc.) n'ont aucune signification et il convient donc de limiter leur nombre le plus possible. "Les propositions logiques sont des tautologies" (6.1) : elles ne "disent" rien, ne représentent rien.
A l'instar des propositions philosophiques, seraient-elles aussi des non-sens ? Non : "elles appartiennent au symbolisme, tout à fait à la manière dont le "0" appartient au symbolisme de l'arithmétique." (4.461) A la différence des philosophèmes, elles ne prétendent pas représenter quelque chose mais rien. La logique montre. Elle "n'est pas une théorie , mais une image qui reflète le monde" (6.13).
"La logique est transcendantale" (6.13) Dont acte. Mais puisqu'il est question de conditions de possibilité, posons une question : ce qui se dit ici de la logique, nommément le Tractatus lui-même, n'outrepasse-t-il pas les bornes qu'il assigne par ailleurs ? Suit-il ses propres règles ? En effet, selon ses propres critères, le Tractatus est un tissu de non-sens puisque ses propositions concernent les faits, les propositions, les objets, etc. et contreviennent par là même au symbolisme logique. En en mot, le Tractatus est bel et bien philosophique.
Cet ouvrage est une entité paradoxale : un non-sens qui trace une frontière entre sens et non-sens, entre ce qui est pensable et ce qui ne l'est pas. En toute rigueur, le Tractatus n'a donc pas pu être pensé ; il n'a pu être que révélé.
Bien entendu, un esprit tel que celui de Ludwig Wittgenstein ne pouvait que s'en aviser. C'est donc pourquoi il affirme : "Mes propositions sont des éclaircissements en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvues de sens" (6.54). Il reste que son ouvrage est un non-sens sensé, ou, tout aussi bien, un "cercle carré" ou même un non-livre. Voilà pourquoi, face aux membres du Cercle de Vienne, Wittgenstein récitait du Tagore. Le Tractatus, sa pensabilité et sa vérité, relèvent du mysticisme : "Il y a assurément de l'indicible. Il se montre, c'est le Mystique." (6.522)
Le Tractatus ne serait-il qu'une longue prétérition ? Il aurait peut-être suffi à Wittgenstein d'énoncer uniquement ceci : "Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence." (7)
20:20 | Lien permanent | Commentaires (0)
04/03/2005
Héraclite d'Ephèse

Héraclite d’Ephèse par René Char (1948) :
« Il paraît impossible de donner à une philosophie le visage nettement victorieux d’un homme et, inversement, d’adapter à des traits précis de vivant le comportement d’une idée, fût-elle souveraine. Ce que nous entrevoyons, ce sont un ascendant, des attouchements passagers. L’âme s’éprend périodiquement de ce montagnard ailé, le philosophe, qui lui propose de lui faire atteindre une aiguille plus transparente pour la conquête de laquelle elle se suppose au monde. Mais comme les lois chaque fois proposées sont, en partie tout au moins, démenties par l’opposition, l’expérience et la lassitude – fonction universelle –, le but convoité est, en fin de compte, une déception, une remise en jeu de la connaissance. La fenêtre ouverte avec éclat sur le prochain, ne l’était que sur l’en dedans, le très enchevêtré en dedans. Il en fut ainsi jusqu’à Héraclite. Tel continue d’aller le monde pour ceux qui ignorent l’Ephésien.
Nos goûts, notre verve, nos satisfactions sont multiples, si bien que des parcelles de sophisme peuvent d’un éclair nous conquérir, toucher notre faim. Mais bientôt la vérité reprend devant nous sa place de meneuse d’absolu, et nous repartons à sa suite, tout enveloppés d’ouragans et de vide, de doute et de hautaine suprématie. Combien alors se montre ingénieuse l’espérance !
Héraclite est, de tous, celui qui, se refusant à morceler la prodigieuse question, l’a conduite aux gestes, à l’intelligence et aux habitudes de l’homme sans en atténuer le feu, en interrompre la complexité, en compromettre le mystère, en opprimer la juvénilité. Il savait que la vérité est noble et que l’image qui la révèle c’est la tragédie. Il ne se contentait pas de définir la liberté, il la découvrait indéracinable, attisant la convoitise des tyrans, perdant son sang mais accroissant ses forces, au centre même du perpétuel. Sa vue d’aigle solaire, sa sensibilité particulière l’avaient persuadé, une fois pour toutes, que la seule certitude que nous possédions de la réalité du lendemain, c’est le pessimisme, forme accomplie du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde et dormir.
Le devenir progresse conjointement à l’intérieur et tout autour de nous. Il n’est pas subordonné aux preuves de la nature ; il s’ajoute à elles et agit sur elles. Sauve est l’occurrence des événements magiques susceptibles de se produire devant nos yeux. Ils bouleversent, en l’enrichissant, un ordre trop souvent ingrat. La perception du fatal, la présence continue du risque, et cette part de l’obscur comme une grande rame plongeant dans les eaux, tiennent l’heure en haleine et nous maintiennent disponibles à sa hauteur.
Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles qu’il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour courir en avant d’eux, tandis qu’au passage il respire dans l’un ou l’autre de nous.
[…] Disant juste, sur la pointe et dans le sillage de la flèche, la poésie court immédiatement sur les sommets, parce que Héraclite possède ce souverain pouvoir ascensionnel qui frappe d’ouverture et doue de mouvement le langage en le faisant servir à sa propre consommation. Il partage avec autrui la transcendance tout en s’abstenant d’autrui. Au-delà de sa leçon, demeure la beauté sa date, à la façon du soleil qui mûrit sur le rempart mais porte le fruit de son rayon ailleurs. Héraclite ferme le cycle de la modernité qui, à la lumière de Dionysos et de la tragédie, s’avance pour un ultime chant et une dernière confrontation. Sa marche aboutit à l’étable sombre et fulgurante de nos journées. Comme un insecte éphémère et comblé, son doigt barre nos lèvres, son index dont l’ongle est arraché. »
09:10 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/03/2005
Tête de Turc

Certains s'en offusquèrent. Acrimonie et incompréhension philosophique ?
Son avocat "sociologique" de circonstance, Pierre Aubenque, le "défendait" ainsi : « [Heidegger] utilise la "révolution" de 1933 pour régler quelques comptes quasiment personnels et satisfaire à travers eux quelques revendications plus générales, notamment contre la bourgeoisie qui ne l'avait pas accueilli et à laquelle il rattachait, à travers la figure de Cassirer et de quelques autres, l'intelligentsia cosmopolite et salonnarde de Berlin. »
Soit un cas : « En position de recteur, Heidegger dénonça un de ses collègues chimistes, Staudinger, à la Gestapo. »
Il s'agit en l'espèce de s'aviser que la déduction correcte est : "Staudinger était un bourgeois". "Hétérochthone" est également admis comme corollaire mais sous réserve d'une axiomatique saturée.
Définitivement, mieux vaut un plaidoyer plus transcendantal, seul digne d'un tel philosophe qu'à l'instar d'Héraclite, on a pu qualifier d'obscur.
Rappelons-nous que c'est aux apparences que s'attache la phénoménologie ou, plus exactement, à l'apparaître en tant que tel. Elle se saisit des genèses, suit au plus près les surfaces des "choses mêmes" puis relie des "profils" dans l'aperception originaire entée au corps propre. Certes, l'on sait que Heidegger a rompu avec son maître Husserl dont il était le plus brillant disciple. Mais, même dissident, il reste phénoménologue. Tâchons en effet de ne pas oublier qu'il promeut, après une rude sélection, le couple "voilement-dévoilement" comme clef du concept de vérité. A l'apparaître phénoménologique, il ajoute son nécessaire corrélat : le disparaître. Il peut réaliser cette prouesse grâce à sa géniale intuition du caractère épiphanique et sacral de la physis qui reste la seule vraie orientation de la pensée : la physiognomonie donc comme relève de la phénoménologie. Voilà un chemin qui mène quelque part.
Comme le dit Hegel, un autre philosophe allemand inspiré, quant à lui, par Napoléon : « La physiognomonie, c'est la science de réduire l'esprit à un os. » Plus fidèle aux Grecs, Heidegger saura perfectionner cette science et ainsi rendre hommage à la conflagration universelle d'Anaximandre.
Le grief qui lui est fait n'est pas fondé : Heidegger est finalement très clair.
10:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
02/03/2005
Le foyer de l'ego

Contre Husserl qui réfère la sphère de la liberté transcendantale à un ego qui en diffère, Sartre, contestant toute position originaire d'un moi, affirme : « Le Je transcendantal, c'est la mort de la conscience » (La transcendance de l'ego, 23). En effet, la conscience sartrienne qui est originairement constituante et révélante, se déploie dans un "champ transcendantal sans sujet » (L'Être et le néant, 280). L'égologie procède donc au refoulement de la liberté absolue : c'est une « doctrine refuge ».
Si, pour Sartre, la conscience reste, à la manière husserlienne, intentionnelle, c'est-à-dire « visée de quelque chose », elle n'est pas connaissance de soi même si elle est principiellement conscience d'elle-même.
En effet, la conscience, spontanée, s'effectue dans un « cogito préreflexif » à la différence de la connaissance qui implique quant à elle le couple sujet-objet. Pour Sartre conscientia n'est pas cum scientia.
Ainsi ce cogito préreflexif insiste-t-il sur la présence à soi immanente et antérieure au « retour à moi » qui naît de la réflexion. La conscience est « être pour soi » et ne se pose pas comme objet : elle est « non thétique ».
Mais d'emblée, avec la réflexion, « le Je apparaît aussitôt » et se donne comme être permanent, substantiel, transcendant. C'est d'une « création continuée » de la réflexion qu'il se soutient. L'ego est comme l'ombre de la synthèse réflexive. En effet, il est rétif à toute intuition directe. « Par nature l'ego est fuyant » puisqu'il se révèle comme la marque même du regard réflexif. Ontologiquement, il ne peut être perçu de face ; par essence, c'est un « profil ». Ce n'est que du «coin de l'oeil », dans un champ de vision latéral et périphérique, que l'on peut, halluciné, l'apercevoir.
L'ego sartrien est donc une illusion d'optique, un reflet fascinant mais fallacieux d'une subjectivité imprésentable.
00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
01/03/2005
Exercice de ventriloquie

« Dans le champ de ma conscience, il n'y a pas de fixité. il ne peut y avoir de fixité. Il n'y a de fixité que par efforts renouvelés... Des épis lèvent de graines que je n'ai pas semées. Dans le champ de ma conscience, il y a d'étranges, d'imprévisibles résonances. » (Michaux, Vents et poussières)

« L'Homme qui te parle est un Sphinx. L'Homme que tu fus, le père que tu as eu était Sphinx. Eh bien, qu'as-tu compris au Sphinx qui te fus soumis ?
Celui qui ne dissout pas celui qui vient à lui, un Sphinx s'y forme et c'est du Sphinx que l'on meurt.
Tout durcit, dit le maître du Ho, tout durcit et revient à la tête. »
(Michaux, Epreuves, exorcismes)
13:40 | Lien permanent | Commentaires (0)



