27/02/2005
Contribution mineure à l'holmésologie

Il faisait fort sombre en cette fin d'après-midi. Le long des façades sévères de Baker Street, des ombres glissaient telles de secrètes émanations de l’infâme boue piétinée par les chevaux de fiacre. Une fine neige avait en effet attristé Londres toute la journée.
Le docteur Watson sortit doucement de son assoupissement passager et contempla avec hébétude son précieux carnet de notes gisant à ses pieds. Sherlock Holmes s'était absenté. Contrairement à son immuable rituel, le détective n'avait pas fait retraite dans sa chambre pour se livrer à "quelques petites expérimentations chimiques". Un sourire aux lèvres, Watson se prit à l'imaginer en train de manipuler éprouvettes et cornues, mêlant des réactifs colorés aux acides et aux bases tandis que le reflet de la flamme du bec Bunsen brillait au fond de ses pupilles dilatées par l’excitation et la solution à 7%.
Le vénérable médecin en avait donc profité pour s'installer dans son fauteuil du living room, un plaid élimé sur les genoux. Avant de sombrer dans un sommeil sans rêve, il avait initialement prévu de tenter d’assembler les éléments épars de l’enquête en cours de son ami. Son retour n'aurait en effet pas manqué de mettre fin à ses cogitations qui se déréglaient invariablement sous de dysharmoniques coups d'archet.
Après de longues années d’intimité avec le célèbre limier, John Watson prêtait moins d’attention aux pompeuses déclarations de Holmes quant à ses méthodes d’investigation. Les multiples subtilités de l’analyse rationnelle, de l’induction et de la déduction qui lui étaient complaisamment détaillées le laissaient désormais de marbre. Pourtant, comme il était admiratif à leurs débuts ! Il avait néanmoins fini par se rendre compte que l’esprit si brillant du détective ne fonctionnait pas ainsi. En réalité, il sautait de-ci de-là tel un chien de chasse flairant les pistes de lièvre ou de sanglier : un buisson de ce côté, une ornière du chemin... L’activité mentale de Holmes était strictement parallèle à celle de son corps. Examinant les lieux d’un crime ténébreux, son long corps mince et noueux se détendait brusquement comme un ressort au moindre signe de cendres issues de tabacs exotiques ou de minuscules particules de sang coagulé...
Subitement, un frisson glacé parcourut l'échine du médecin. Et c'est en cet instant qu'il comprit tout.
Au premier coup de minuit, Sherlock Holmes rentra au bercail. Etonné, il salua sèchement Watson puis s'enquit de sa veille prolongée. Il n'obtint toutefois que cette réponse inappropriée et laconique :
"Vous savez, Irène Adler m'a tout dit."
Les deux hommes échangèrent longuement un étrange regard. Holmes finit par baisser les yeux. Ses mâchoires se mirent à se contracter compulsivement tandis que sa paupière droite fut prise d'un tremblement irrépressible.
Posément, Watson se leva et lui fit face.
"Madame Hudson ne rentrera que tard dans la matinée" annonça-t-il, mâle et goguenard.
Une heure plus tard, Holmes, épuisé et amer, la main serrée sur sa propre gorge, s'enfermait dans sa chambre-laboratoire. On put certes l'entendre ouvrir quelque tiroir mais la détonation fut pourtant quasi immédiate.
Ce n'est qu'aux premières heures du jour que le coroner et ses acolytes arrivèrent, accompagnés d'un homme trapu au visage grave et énigmatique.
"Mycroft, je suis désolé" lui dit Watson d'un air matois.
L'homme le foudroya du regard.
20:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
26/02/2005
Splendeur du "on"
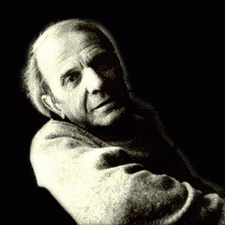
Un concept philosophique remplit une ou plusieurs fonctions, dans des champs de pensée qui sont eux-mêmes définis par des variables intérieures. Il y a enfin des variables extérieures (états de choses, moments de l’histoire), dans un rapport complexe avec les variables internes et les fonctions. C’est dire qu’un concept ne naît et ne meurt pas par plaisir, mais dans la mesure où de nouvelles fonctions dans de nouveaux champs le destituent relativement. C’est pourquoi aussi il n’est jamais très intéressant de critiquer un concept : il vaut mieux construire les nouvelles fonctions et découvrir les nouveaux champs qui le rendent inutile ou inadéquat.
Le concept de sujet n’échappe pas à ces règles. Il a longtemps rempli deux fonctions: d’abord une fonction d’universalisation, dans un champ où l’universel n’était plus représenté par des essences objectives mais par des actes noétiques ou linguistiques. En ce sens, Hume marque un moment principal dans une philosophie du sujet, parce qu’il invoque des actes qui dépassent le donné (qu’est-ce qui se passe lorsque je dis « toujours" ou « nécessaire" ?). Le champ correspondant, dès lors, n’est plus tout à fait celui de la connaissance, mais plutôt celui de la « croyance" comme nouvelle base de la connaissance : à quelles conditions une croyance est-elle légitime, d’après laquelle je dis plus que ce qui m’est donné ? En second lieu, le sujet remplit une fonction d’individuation, dans un champ où l’individu ne peut plus être une chose ni une âme, mais une personne, vivante et vécue, parlante et parlée ("je-tu"). Ces deux aspects du sujet, le Je universel et le moi individuel, sont-ils nécessairement liés ? Même liés, n’y a-t-il pas conflit entre eux, et comment résoudre ce conflit ? Toutes ces questions animent ce qu’on a pu appeler philosophie du sujet, déjà chez Hume, mais aussi chez Kant qui confronte un Je comme détermination du temps et un Moi déterminable dans le temps. Chez Husserl encore, des questions analogues se poseront dans la dernière des Méditations cartésiennes.
Peut-on assigner de nouvelles fonctions et variables capables d’entraîner un changement ? Ce sont des fonctions de singularisation qui ont envahi le champ de la connaissance, à la faveur de nouvelles variables d’espace-temps. Par singularité, il ne faut pas entendre quelque chose qui s’oppose à l’universel, mais un élément quelconque qui peut être prolongé jusqu’au voisinage d’un autre, de manière à obtenir un raccordement : c’est une singularité au sens mathématique. La connaissance et même la croyance tendent alors à être remplacées par des notions comme "agencement" ou "dispositif" qui désignent une émission et une répartition de singularités. Ce sont de telles émissions, du type "coup de dés", qui constituent un champ transcendantal sans sujet. Le multiple devient le substantif, multiplicité, et la philosophie est la théorie des multiplicités, qui ne se rapportent à aucun sujet comme unité préalable. Ce qui compte n’est plus le vrai ni le faux, mais le singulier et le régulier, le remarquable et l’ordinaire. C’est la fonction de singularité qui remplace celle d’universalité (dans un nouveau champ qui n’a plus d’usage pour l’universel). On le voit même en droit : la notion juridique de "cas", ou de « jurisprudence » se passe de tout "sujet" de droits. Inversement une philosophie sans sujet présente du droit une conception fondée sur la jurisprudence.
Corrélativement peut-être, se sont imposés des types d’individuation qui n’étaient plus personnels. On s’interroge sur ce qui fait l’individualité d’un événement : une vie, une saison, un vent, une bataille, cinq heures du soir… On peut appeler heccéité ou eccéité ces individuations qui ne constituent plus des personnes ou des moi. Et la question naît de savoir si nous ne sommes pas de telles heccéités plutôt que des moi. La philosophie et la littérature anglo-américaine à cet égard sont particulièrement intéressantes, parce qu’elles se sont souvent distinguées par leur incapacité à trouver un sens assignable au mot "moi", sauf celui d’une fiction grammaticale. Les événements posent des questions de composition et de décomposition, de vitesse et de lenteur, de longitude et de latitude, de puissance et d’affect très complexes. Contre tout personnalisme, psychologique ou linguistique, ils entraînent la promotion d’une troisième personne, et même d’une "quatrième" personne du singulier, non-personne ou Il, où nous nous reconnaissons mieux, nous-mêmes et notre communauté, que dans des vains échanges entre un Je et un Tu. Bref, nous croyons que la notion de sujet a perdu beaucoup de son intérêt au profit des singularités pré-individuelles et des individuations non-personnelles. Mais, précisément, il ne suffit pas d’opposer des concepts les uns aux autres pour savoir lequel est le meilleur, il faut confronter les champs de problèmes auxquels ils répondent, pour découvrir sous quelles forces les problèmes se transforment et exigent eux-mêmes la constitution de nouveaux concepts. Rien ne vieillit de ce que les grands philosophes ont écrit sur le sujet, mais c’est la raison pour laquelle nous avons, grâce à eux, d’autres problèmes à découvrir, plutôt que d’opérer des "retours" qui montreraient seulement notre insuffisance à les suivre. La situation de la philosophie ne se distingue pas ici fondamentalement de celle des sciences et des arts. (Deleuze, Réponse à une question sur le sujet)
18:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
24/02/2005
Le maître mesuré

« Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui
Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre
Ce lac dur oublié que hante sous le givre
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui!
Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui
Magnifique mais qui sans espoir se délivre
Pour n'avoir pas chanté la région où vivre
Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui.
Tout son col secouera cette blanche agonie
Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie,
Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.
Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne,
Il s'immobilise au songe froid de mépris
Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne. »
(Mallarmé)
L'austère Logos persévère tandis que les phalanges viriles de ces vers lancent ce que Deleuze nomme des « émissions secrètes ». La décence : le plaisir du sens.
19:10 | Lien permanent | Commentaires (0)
23/02/2005
Anti-scepticisme
Enfin, avec ceux-là il ne faut pas parler de sciences (car pour nous ce qui est de l’usage de la vie et de la société, la nécessité les a contraints à supposer qu’ils sont, à rechercher ce qui leur est utile, et à faire sous la foi du serment quantité d’affirmations et de négations). Car, si on leur prouve quelque chose, ils ne savent pas si l’argumentation est probante ou déficiente. S’ils nient, concèdent, ou objectent, ils ne savent pas qu’ils nient, concèdent ou objectent ; et par suite, il les faut tenir pour des automates tout à fait dépourvus d’esprit. »
Spinoza, Tractatus de Intellectus Emendatione, § 47 et § 48 (tr. Pautrat)

Peut-être est-il loisible de déceler dans ce texte une attaque masquée contre le cartésianisme et son doute méthodique. Alors, une gigantomachie des méthodes ?
Non. Descartes est un faux sceptique ; son doute n'est préalable que pour être, définitivement et en substance, éradiqué. Sa propédeutique a en fait pour vocation de mettre en scène la transcendance divine et non, comme on le répète absurdement, le Cogito. Celui-ci ne se soutient en effet que de la présence de l'idée incompréhensible d'infini en son sein.
En réalité, c'est à un hommage à Descartes auquel Spinoza se livre ici. Comparant les misologues sceptiques à des « automates tout à fait dépourvus d’esprit », il les subsume sous le concept cartésien d'animal.
A l'inverse de l'animal toutefois, c'est à l'infini que le sceptique régresse. A rebours, il s'agit d'intuitionner que toute assertion n'est pas fausse. Sceptique est une âme morte dans la fosse amère de son esprit.
20:20 | Lien permanent | Commentaires (0)
22/02/2005
"Philosophistique"
« L’Etranger : [...] l’art fondé sur l’opinion, lequel est une partie de l’art de la contradiction [...] lequel se rattache à l’art de produire des images, [...] lequel se spécialise dans les discours et fabrique des prestiges, voilà, peut-on dire, "la lignée et le sang" dont le véritable sophiste descend, et l’on dira, selon moi, l’exacte vérité. »

[...] « L'Etranger : C'est que, réellement, cher jeune homme, notre recherche est extrêmement difficile. Qu'une chose apparaisse ou semble, sans cependant être, et que l'on dise quelque chose, sans cependant dire la vérité, voilà que tout cela est plein de difficultés, non seulement à l'heure actuelle et dans le passé, mais toujours. Car il est tout à fait difficile de trouver un moyen pour expliquer comment est-il nécessaire que dire ou penser le faux soit réel, sans être empêtré dans une contradiction quand on prononce cela.
Théétète : Pourquoi ?
L'Etranger : Parce que cet argument a l'audace de supposer que le non-être existe, car, autrement, le faux ne pourrait pas devenir une chose qui est. Mais le grand Parménide, mon enfant, quand nous-mêmes étions des enfants, témoignait de cela d'un bout à l'autre, aussi bien en prose qu'en vers, chaque fois qu'il disait : "Que ceci ne soit jamais imposé : qu'il y a des choses qui ne sont pas. Quand tu recherches, éloigne ta pensée de ce chemin. » (Platon, Le Sophiste).
« Ceux qui insistent sur la différence entre l’être et le néant feraient bien de nous dire en quoi elle consiste » (Hegel, Science de la logique).
« Ceux qui se posent la question de savoir s’il faut ou non honorer les dieux et aimer ses parents n’ont besoin que d’une bonne correction, et ceux qui se demandent si la neige est blanche ou non n’ont qu’à regarder. » (Aristote, Topiques).
Peut-être.
Pourtant, pourtant, l'opposition statique entre philosophie et sophistique n'est-elle pas une dogmatique stérile ? Cela revient à faire l'économie du biais par lequel le vrai peut se proférer : le langage lui-même, ses myriades de ruses, de gouffres et de révélations inopinées. Toute parole s'autorise du seul fait qu'elle parle. Ce qui se dit avec Lacan : « Il n'y a pas de métalangage ».
La philosophie et la sophistique sont en état de perpétuel encerclement mutuel. Leur distinction est a priori indécidable. Mais elle doit, à chaque fois, être décidée. Et la décision ne peut se faire qu'à l'issue d'un impitoyable affrontement des discours (oui, d'une logomachie aussi...) et de créations conceptuelles inouïes. C'est une guérilla incertaine, une guérilla interne au penseur lui-même. Il est notoire en effet que la pensée est ce qui s'impose à qui ne l'a pas pensé.
06:55 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/02/2005
L'anomalie du mental
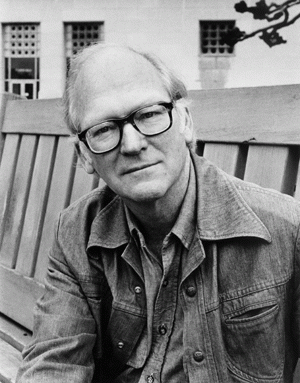
Grâce à son ouvrage Actions et événements (1993), Donald Davidson (1917-2003) est l'unique philosophe de son obédience (Philippe de Rouilhan étant un cas limite) a avoir eu l'honneur d'être publié dans la collection Epiméthée des Presses Universitaires de France dirigée depuis 1981 par Jean-Luc Marion.
A la manière d'un Leibniz ou d'un Whitehead (qu'il a longtemps admiré), Davidson est un philosophe de l'événement. Au sein d'un matérialisme de bon aloi, il parvient à éviter l'écueil majeur du réductionnisme plat. Sans pour autant verser dans le fonctionnalisme, Davidson reconnaît en effet une certaine autonomie au mental. Comme le dit Pascal Engel : « La thèse du caractère non nomologique des régularités psychologiques, et celle du caractère non nomologique des corrélations psychophysiques est ce que Davidson appelle "anomisme du mental" : le mental et les relations du mental au physique ne sont pas soumis à des lois strictes. Il s'ensuit que le matérialisme réductionniste qui présuppose l'existence de telles lois, est impossible. »
Voici comment Davidson procède pour expliciter sa position philosophique très originale.
Soient trois assertions:
(1) Des événements physiques sont causalement reliés à certains événements mentaux. C'est le cas typique de l'action et de la perception.
(2) S'il y a relation de causalité, alors il y a loi stricte.
(3) Les événements mentaux ne sont pas prédictibles par des lois déterministes strictes.
Il semble que la causalité mentale (1), la légalité de la causalité (2), et l'anomisme du mental (3), soient incompatibles. Pourtant, pour Davidson, ces thèses peuvent coexister.
Comment ?
Revenons d'abord à son ontologie de l'événement qui peut se formuler en quatre thèses :
- Il est impossible de réduire les événements à des propriétés de choses. Bien plus, ce sont les propriétés de choses qui sont réductibles aux événements.
- Un événement a une localisation spatio-temporelle et se trouvent pris dans des relations de causalité.
- Les événements dont la description contient un prédicat mental s'avèrent être des événements mentaux.
- Les événements dont la description contient un prédicat physique s'avèrent être des événements physiques.
Ceci n'est possible qu'avec une conception bien particulière de la causalité. En effet, un événement B est causé par un événement A si et seulement si, A satisfaisant à une description 1 et B satisfaisant à une description 2, il y a une loi telle que tous les événements satisfaisant à 1 entraînent tous des événements satisfaisants à 2. Ainsi, un événement n'est soumis à une loi qu'en tant qu'il est décrit d'une certaine façon. Toutefois, si la causalité existe pour les événements eux-mêmes, indépendamment de la manière dont ils sont décrits, elle ne se manifeste que dans certaines descriptions.
De plus, selon sa doctrine du holisme du mental, Davidson soutient qu'il est impossible de n'attribuer qu'une unique attitude intentionnelle à un locuteur puisque toute croyance a pour corrélat plusieurs autres croyances. Même si certaines desdites croyances sont irrationnelles, il s'agit, selon le fameux "principe de charité", de présupposer que le système qu'elles forment est rationnel, c'est-à-dire non contradictoire. Ainsi, est-on tenu d'inférer q si le locuteur soutient p et si q est une conséquence logique de p. C'est le critère dit de rationalité.
Ceci posé, il est à remarquer que seules les descriptions physiques sont justiciables de lois strictes. En effet, soumis au critère de rationalité, les événements décrits en tant qu'événements mentaux ne tombent pas sous des lois strictes puisque leur description est par définition révisable.
Ainsi :
(i) Si A croit que p, alors le cerveau de A a une propriété neuronale N selon une loi psycho-physique.
(ii) Si le cerveau de A a la propriété neuronale N, alors A croit que p.
(iii) N est attribuée en dépit du réquisit de rationalité sus-mentionné.
Conséquence de (iii) :
(iv) L'abandon de l'attribution de la propriété N du cerveau de A n'est pas justifiée par d'autres croyances de A.
Conséquence de (ii) et de (iv) :
(v) D’autres croyances de A ne peuvent pas non plus justifier l’abandon de l’attribution de la croyance p à A.
(vi) Le holisme mental est contredit par (v) ce qui implique que, pour Davidson, (i) est faux.
Les prédicats physiques et les prédicats mentaux ne peuvent donc pas s'accorder. Mais les événements mentaux et les événements physiques sont identiques. S'il s'agit donc bien ici d'un matérialisme, ce n'est pourtant pas un réductionnisme. En effet, les propriétés et les descriptions des ces événements sont différentes : il n'y a pas de lois strictes qui relient les descriptions mentales et les descriptions physiques. Il y a donc, à proprement parler, une anomalie du mental.
00:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
13/02/2005
Combinatoire et épuisement
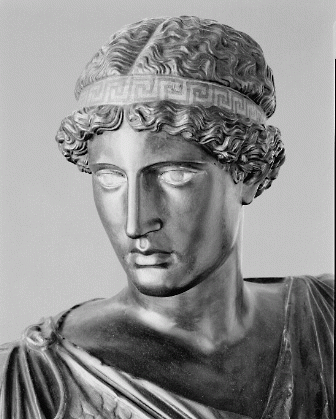
Extrait de Deleuze, L’épuisé, postface à Beckett, Quad, Editions de Minuit :
« La combinatoire est l’art ou la science d’épuiser le possible, par disjonctions incluses. Mais seul l’épuisé peut épuiser le possible, parce qu’il a renoncé à tout besoin, préférence, but ou signification. Seul l’épuisé est assez désintéressé, assez scrupuleux. Il est bien forcé de remplacer les projets par des tables et des programmes dénués de sens. Ce qui compte pour lui, c’est dans quel ordre faire ce qu’il doit, et suivant quelles combinaisons faire deux choses à la fois, quand il le faut encore, pour rien. Le grand apport de Beckett à la logique est de montrer que l’épuisement (exhaustivité) ne va pas sans un certain épuisement physiologique : un peu comme Nietzsche montrait que l’idéal scientifique ne va pas sans une sorte de dégénérescence vitale, par exemple chez l’Homme à la sangsue, le consciencieux de l’esprit qui voulait tout connaître du cerveau de la sangsue. La combinatoire épuise son objet, mais parce que son objet est lui-même épuisé. L’exhaustif et l’exhausté (exhausted). Faut-il être épuisé pour se livrer à la combinatoire, ou bien est-ce la combinatoire qui nous épuise, qui nous mène à l’épuisement, ou bien les deux ensemble, la combinatoire et l’épuisement ? Là encore, disjonctions incluses. Et c’est peut-être comme l’envers et l’endroit d’une même chose: un sens ou une science aiguë du possible, jointe ou plutôt disjointe à une fantastique décomposition du moi. Ce que Blanchot dit de Musil, à quel point c’est vrai de Beckett : la plus haute exactitude et la plus extrême dissolution ; l’échange indéfini de formulations mathématiques et la poursuite de l’infime ou de l’informulé. Ce sont les deux sens de l’épuisement, il faut les deux pour abolir le réel. Beaucoup d’auteurs sont trop polis, et se contentent de proclamer l’oeuvre intégrale et la mort du moi. Mais on reste dans l’abstrait tant qu’on ne montre pas "comment c’est", comment on fait un "inventaire", erreurs comprises, et comment le moi se décompose, puanteur et agonie comprises : ainsi Malone meurt. Une double innocence, car, comme dit l’épuisé(e), "l’art de combiner ou la combinatoire n’est pas ma faute, c’est une tuile du ciel. Pour le reste je dirais non coupable" (Assez in Beckett, Têtes mortes, p.36).»
09:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
11/02/2005
Epiménide ! Epiménide !

Partons d'un cas concret : Epiménide se contredit, encore et encore, en actes et en paroles.
Que faire ? Qu'en penser ? Est-il possible de faire cesser cette prolifération incontrôlable ?
Pas à pas, sans effet rhétorique et en gardant notre calme, tentons d'analyser.
La contradiction est-elle consciente ou inconsciente ? Ladite contradiction, donc, relève-t-elle d’une volonté délibérée ou bien est-elle le résultat de processus inconscients ? S’il s’agit d’une conduite inconsciente, elle peut relever de deux types : la bêtise (incapacité à saisir la contradiction en elle-même et donc la non-conscience de celle-ci) ou bien la pathologie mentale. Parler de pathologie n'implique bien entendu ni jugement de valeur ni donc jugement moral. Car, s’il y a pathologie ce n’est pas parce que se manifeste une non conformité à un quelconque modèle extérieur mais parce qu’il y a souffrance.
En effet, la contradiction, comme plus généralement la logique, est un critère objectif et public dont le respect est nécessaire pour quelque pensée que ce soit. Si la contradiction n’est pas reconnue, elle n’en est pas moins existante et elle se manifeste par ses conséquences : il y a souffrance. On peut donc dire, en ce sens, que la bêtise est une pathologie parce qu’elle entraîne les mêmes effets. On peut même avancer l’hypothèse que la bêtise serait l’effet d’une pathologie, un symptôme en quelque sorte. La pathologie rendrait bête. Mais la bêtise secrèterait son propre anesthésiant en opérant la projection de la souffrance. Le népenthès pour Epiménide : faire souffrir. Alors, sciemment ou non ?
Ceci pose une question philosophique majeure : le libre-arbitre est-il nécessaire à la responsabilité ? L’instance arbitrale du sujet, dans le cas qui nous occupe, n’est pas libre ; ces critères ne sont pas fixes puisque l’absence de possibilité de contradiction rend tout ce qu’ils sont censés distinguer indiscernable. Par exemple : (A) « Le chien Bill est dans le salon » et (B) « Le chien Bill n’est pas dans le salon » sont deux propositions contradictoires, c’est-à-dire mutuellement exclusives. En effet, il est impossible que le chien Bill soit et ne soit pas à la fois (si on conserve la stabilité terminologique de chacun des termes équivalents dans A et B) dans la pièce. Le sujet n’est pas libre de choisir entre les deux membres mutuellement exclusifs d’une alternative puisque pour ledit sujet les deux membres sont les mêmes, c’est-à-dire qu’il n’y a pas pour lui alternative mais équivalence parfaite (entre blanc et noir par exemple). Si l’on s’autorise une métaphore visuelle, cette pathologie bêtifiante aveugle. Et le concept primaire de couleur est « incompréhensible » pour un aveugle. La question se transforme alors : peut-on être à la fois arbitraire et responsable de ces actes ?
La réponse est immédiate si à l’arbitraire se joint la conscience de cet arbitraire. Le sujet connaît les règles objectives et les enfreint à son profit. Il se fait passer pour « aveugle » ou « bête » pour « jouer sur les deux tableaux ». Il est de mauvaise foi. Il est donc évidemment responsable. En revanche, si, comme dans la possibilité que nous considérons ici, le sujet est positivement incapable de faire la différence, est-il encore responsable ? Il convient de préciser d’abord le concept de responsabilité. Mais il s’agit de la distinguer de la causalité. Le sujet est cause de la non-perception. On pourrait rétorquer : la non-perception est-elle vraiment quelque chose du même ordre que la perception, à savoir, à la différence de cette dernière, n’est-elle pas qu’une abstraction ? Certes, et de grands esprits l’ont pensé. Cependant, ceux-ci ne prétendaient pas que l’effet produit (i.e. la non-perception) était causée par un autre capable, lui, de percevoir.
Pour faire simple, l’argument infantile « je ne l’ai pas fait exprès » est-il recevable ? Donc s’il est employé lorsque, réellement, « je ne l’ai pas fait exprès », y a-t-il responsabilité ? Si l’on admet que non, il y a irresponsabilité dudit sujet. Celui-ci ne peut pas répondre de ses actes, il ne peut pas répondre des conséquences de son arbitraire, il n’est pas responsable de « sa bêtise » (dans les deux sens du terme). Qui doit en répondre dans ce cas ? Est-ce celui qui en a subi les conséquences ? Si oui, est-ce plus juste que ce soit celui-ci plutôt que l’autre ? Le sujet arbitraire considère donc qu’il existe bien un concept de responsabilité puisqu'il l’applique de fait au sujet lésé. En effet, même s’il ne reconnaît pas son acte, il implique, par le fait même de ne pas le reconnaître, c’est-à-dire en imputant à celui qui lui impute son acte cette imputation même, qu’il considère le sujet n°2 comme capable de responsabilité. Et, par là même, il montre qu’il comprend le concept de responsabilité. De même s’il le traite de fou ou de dément, c’est-à-dire d’irresponsable, c’est-à-dire de sujet incapable de répondre de ses actes. En effet le concept d’irresponsabilité est construit à partir de celui de responsabilité ; donc le premier implique le second, c’est-à-dire que la négation du second implique celle du premier. Quand on affirme l’existence du concept d’irresponsabilité on affirme donc en même temps celle du concept de responsabilité. Le sujet arbitraire qui prétend ne pas se savoir tel ne nie donc pas qu’il puisse exister des sujets arbitraires auxquels sont susceptibles de s’appliquer le couple conceptuel responsabilité - irresponsabilité.
Il faut noter que, plus généralement, la louange et le blâme, le mérite et le démérite sont des notions subsumées sous le concept de faute et donc que tout reproche ou compliment utilise implicitement le concept de sujet. Le sujet arbitraire qui est capable d’imputer une responsabilité ou une irresponsabilité est aussi capable d’utiliser le concept de sujet c’est-à-dire celui du substrat de la responsabilité. Pour être totalement irresponsable ledit sujet arbitraire ne doit pas se considérer lui-même comme un sujet. Soit il n’a pas conscience de sa propre existence, c’est-à-dire pas de conscience tout court et il est, ipso facto, incapable d’imputer la responsabilité, c’est-à-dire de reconnaître un quelconque sujet. Soit, il est conscient à un certain degré et il est capable de reconnaître l’existence d’un sujet. Sauf dans un cas : celui qui le concerne. On pourrait poser la question : pour qui se prend-il ? Elle serait mal formulée. Ce serait plutôt pour quoi se prend-il ? Car en bon adversaire de l’animiste il n’accorderait la subjectivité qu’à un "qui" et pas à un "quoi" (un animiste, quant à lui, ne perçoit que des "qui" et n’est donc pas animiste non plus).
Il serait donc pour lui-même une sorte de "quelque chose", un objet en tous cas. Il ne se définirait que par rapport aux autres sujets mais ce, en tant qu’objet. Puisqu’il est objet pour lui-même mais aussi doué d’un certain niveau de conscience, il est image pour lui-même, c’est-à-dire un produit de réflexivité. Il n’est donc ni actif (car il serait sujet pour lui-même) ni objectivement passif mais réactif. Il n’agit pas, il se croit agi puisqu’il se pense pour lui-même objet donc passif. D’où : égoïsme forcené, narcissisme c’est-à-dire fascination envers son image. De plus, son Ego (le sujet en tant qu’objet pour le sujet lui-même) ne peut être affecté que d’un coefficient d’agrandissement (fascination et pas répulsion, donc narcissisme). En effet, lors de son interaction envers d’autres choses (animaux, sujets humains, egos, objets inanimés…), il est statistiquement impossible qu’il n’ait pas rencontré au moins une fois un sujet humain qui lui ait imputé une responsabilité. Il a considéré ce sujet humain comme tel puisqu’il a projeté la responsabilité sur celui-ci (en effet : seul un sujet peut être dit responsable). Mais seulement en théorie. En effet, si ladite responsabilité impliquait quelque chose de positif, cet ego ne l’a pas rejeté puis projeté.
Il a en fait accompli une étrange opération. S’il avait assumé la responsabilité pour obtenir la positivité qu’elle impliquait, il se serait reconnu sujet. Ce qu’il a fait, c’est attribuer la positivité à son image elle-même telle une émanation de son ego. Le sujet humain qui, dans ce cas, lui a imputé une responsabilité positive, ne joue pour lui qu’un rôle de révélateur, une sorte d’écran révélant la lumière émise par son ego. La positivité en jeu était donc de tout temps un attribut de son ego mais il lui manquait juste le révélateur adéquat. Que ce serait-il passé si la responsabilité imputée par le sujet humain avait été négative. Il l’aurait cette fois imputée au sujet humain ; ce dernier aurait été porteur de la négativité. Car étant irresponsable, il ne peut répondre de la négativité ; celle-ci ne peut pas être dite sienne car, par définition, elle ne pourrait être que constitutive de son ego. Jamais il ne pourrait produire autre chose que cette négativité dans cette situation-là. Or, la responsabilité, c’est d’abord être capable de changer de comportement. Et c’est ici impossible. Donc, pour lui, c’est le sujet humain qui est responsable, support de la négativité produite et ce, nécessairement.
C’est ce qui explique que ledit ego ne peut que « gonfler », qu’augmenter. En effet, à chaque responsabilité qu’on lui impute positivement, il découvre un nouveau pan magnifique de son ego immuable et, inversement, à chaque responsabilité qu’on lui impute négativement, celle-ci fait partie du sujet qui lui impute et donc il découvre une nouvelle différence en sa propre faveur puisque le sujet qui lui fait face porte de la négativité, mais lui, uniquement de la positivité. Il lui arrive donc de souffrir (par exemple d"injustices"…) mais il s’aime de plus en plus. Il se croit tout à fait sain d’esprit et doué de cette étrange particularité (pour lui véritable hapax), être ni responsable ni irresponsable : une exception radicale et complète à la logique autrement universelle. Il ne peut commettre d’erreur ni être le lieu d’aucune contradiction. Il est probable (qu’il le sache ou non) qu’il se prenne pour Dieu. A l’instar de ce Dernier, il n’est pas soumis aux mêmes principes que ceux qui régissent les êtres humains.
Epiménide ! Epiménide !
11:50 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/02/2005
Meis et amicis

Ce rien que vous trouvez au fond de "vous-mêmes" n’est pas manque ("structural" selon l’une de ses dernières versions) comme tentent de vous le faire croire ces rudimentaires sophistes.
Ledit rien ne serait manque que s’il y avait possibilité de quelque chose en son lieu. Certes, en fins rhéteurs, certains demi habiles ne laisseront pas de vous opposer que le manque est précisément quelque chose. Ce qui est vrai, indubitable même. N'est-ce pas ce que laissait entendre le malicieux Descartes avec son Cogito ?
Restons donc Classiques : nous réaffirmons que « le néant n’a pas de propriétés ». Nous récusons tout "effet", toute mystification, et ce, en tant que vilenie. Vous ne trouverez le plein que là où il ne manque pas, c’est-à-dire là où il est. Il ne pourrait manquer là où il n’est pas que s’il y était. Ce qui revient à dire qu’il est logiquement contradictoire qu’il manque. En effet, il ne manque pas à sa place puisque ce n’est pas la sienne.
Certes, il y a du vide là où vous cherchez du plein.
Mais la question est : qui a intérêt à mettre votre désir, qui ne manque de rien, dans une impasse ? Qui peut vouloir ériger la contradiction en fondement de l’ontologie ? Ceux qui satisfont le leur de votre impuissance, ceux qui règnent par et sur l'angoisse. Car, et c'est l'unique axiome de leur "science", ils n'ignorent pas que l'angoisse est le lien au manque.
Le logion parménidien doit donc être tenu : « L'Être est, le non-Être n'est pas ».
Shaw, lucide, ironise : « liberté implique responsabilité ; c'est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent. » Il en va de même pour l’intellection : jamais ceci à votre place on ne le pourra. Même s’il eût mieux valu qu’il se l’appliquât à lui-même (De Quincey, dans son chef-d'oeuvre, nous le confirme), Kant donnait un conseil avisé : « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. »
Puisque le Socius ne subsume en fait que flatus vocis de rôles théâtraux, ceux-ci dureront tant que chacun en jouira, c’est-à-dire y trouvera la satisfaction spéculaire de son désir cavernicole.
Seulement, ces saynètes éculées, profondément, nous ennuient. Et ici nul Lycée, Jardin ou Portique. Au contraire, par une singulière transformation topologique, en lieu et place, ne se donne à voir sur l’Agora désaffectée que la version scénique pour abêtis du pourtant universel Roman de Renart.
L'alternative est : le fantasme, on le dissipe ou en jouit.
00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
08/02/2005
Qui est le juif d'Amsterdam ?

« Les Messieurs du Mahamad décidèrent que ledit Spinoza serait exclu et écarté de la nation d'Israël à la suite du herem que nous prononçons en ces termes : A l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de nos saints livres et des six cent treize commandements qui y sont enfermés (...) Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit ; qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille (...) Veuille l'Eternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser contre lui tous les maux mentionnés dans le livre de la Loi ; que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël...» Le décret d'excommunication s'achève par cet avertissement : « Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation ni écrite ni verbale. Qu'il ne lui soit rendu aucun service et que personne ne l'approche à moins de quatre coudées. Que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits. »
Voici la réponse de Spinoza :
« A la bonne heure (...), on ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. Mais, puisqu'on le veut de la sorte, j'entre avec joie dans le chemin qui m'est ouvert, avec cette consolation que ma sortie sera plus innocente que ne fut celle des premiers Hébreux hors d'Egypte. »
Le philosophe polisseur de lentilles gardera néanmoins toute sa vie le manteau déchiré par le couteau d'un fanatique juif pour se rappeler, dit-il, que « la pensée n'est pas toujours aimée des hommes ».
Spinoza est-il comme le dit Leibniz, « un cartésien immodéré » ? Ou bien est-ce le « Gottvertrunkene Mann » que décrit Novalis ? Ou encore un « somnambule cartésien-cabaliste » tel que l’affirme Hamann ? Pierre Bayle, dans l’article Spinoza de son Dictionnaire (édition de 1702), en fait un contempteur du principe aristotélicien de contradiction, un « athée vertueux » et un métaphysicien dédaigneux de l’expérience. De même, le spinozisme y est vu comme un avatar de l’hylozoïsme antique et de la pensée « orientale ». A sa suite, Malebranche le mettra en parallèle avec la philosophie chinoise dont l’Europe commence à prendre connaissance avec les premières relations des missionnaires. Mais on verra aussi dans la philosophie de Spinoza la marque du panthéisme des philosophes italiens de la Renaissance. Il faut d'ailleurs avoir à l'esprit qu'au dix-huitième siècle le terme de "spinoziste" est employé comme une injure. Quant à Hegel, tout en reconnaissant que « Spinoza est un point crucial dans la philosophie moderne » et que « l’alternative est : Spinoza ou pas de philosophie », il définit le spinozisme comme un acosmisme d’où l’histoire est absente. Spinoza est pourtant l’auteur de deux ouvrages politiques majeurs. Au vingtième siècle, Deleuze et Guattari désignent Spinoza comme « le prince des philosophes » tandis qu'il se voit relégué en annexe sous la rubrique des « théologiens juifs médiévaux » dans une Histoire de la philosophie politique.
On pourrait multiplier indéfiniment ce genre d’exemples.
Pour le moins, et quel que soit le sens que l’on peut donner à cette sentence de Martial Gueroult, « dans le ciel de la philosophie, Spinoza n’a cessé de briller d’un éclat singulier. »
00:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/02/2005
Badiou le diadoque

Comme tous les jeunes philosophes de sa génération, et avant d'être requis par l'anti-philosophe Lacan venu avec désinvolture débaucher les normaliens jusque dans leur tour d'ivoire marxisée de la rue d'Ulm, Alain Badiou a d'abord été sartrien. Il deviendra ensuite un diadoque maoïste qui sévira dans le chaudron de l'université de Vincennes. En sortira un livre, chapitré comme s'il s'agissait d'un séminaire de Lacan, Théorie du sujet.
Cet ouvrage, bien que parcouru de brillantes intuitions, est, quant à la forme et au fond, tout entier sous l'empire de Lacan ; un Lacan cependant travesti par le fantasme badiousien en théoricien marxisant de la révolution culturelle. Rappelons en effet le dictum cinglant du psychanalyste aux cigares tordus qui fut assené aux étudiants de Vincennes qui le sommaient alors de se joindre à leur insurrection : "Ce à quoi vous aspirez en tant que révolutionnaires, c'est à un maître ; vous l'aurez". Cette fois, les borroméens s'éclipsent face au gordien. Il est tranché, et proprement. Freud oui. Marx non. Cela, Badiou mettra quelques années pour parvenir à le symboliser. Ce phénomène est d'autant plus étrange que les duettistes Deleuze et Guattari, à quelques amphithéâtres de là, et bien qu'anti-lacaniens, avaient, dès 1972, sursumé avec éclat le couple Marx-Freud. Badiou, on le voit, semblait sur une voie de garage philosophique.
Pourtant, en 1988, un météore illumine le ciel de la philosophie française : L'Être et L'Evénement paraît. Peu s'en avisent. Peu le lisent. Mais c'est un diamant. Il faudra quelques années pour que les esprits distingués commencent à s'émouvoir (sans, il est vrai, condescendre à le lire dans les détails). Il faut dire que Badiou, durant les débuts de l'ère mitterrandienne dominée par les grotesques "nouveaux philosophes", n'a pas perdu son temps. Dans le sillage des découvertes de Cantor, il assimile les théorèmes et les innombrables chicanes du massif logico-mathématique de la théorie des ensembles.
Les thèses de l'Être et l'Evénement sont radicales. L'ontologie est virilement égalée à la mathématique. Ce qui, après des siècles de métaphysique, semblait le domaine réservé et exclusif de la philosophie, se voit annexé à l'activité aveugle des mathématiciens. Heidegger l'ontologue est salué poliment puis renvoyé à l'équivoque du poème. C'est le mathème qui désormais régira le discours ontologique. Ce que le Cercle de Vienne et la philosophie anglo-saxonne avait entériné, à savoir la nouvelle logique issue notamment de Frege et de Russell puis couronnée par Gödel et Cohen, Badiou s'en saisit. Il ne s'agit pas pour lui de réduire la logique mathématique à un jeu de langage. En effet, le tournant langagier qu'emprunta la philosophie analytique est un chemin qui ne mène nulle part. Ceci est clair dès après Quine.
Badiou agit donc en grand stratège. L'Un n'est pas, seul le multiple tissé de vide est. La théorie mathématique des ensembles est l'unique biais intellectuel pour traiter le multiple pur inconsistant. En se faisant plus logicien que les philosophes analytiques, Badiou les coupe de leurs arrières. Mais n'est-ce pas une victoire à la Pyrrhus ? La philosophie devient dorénavant l'administratrice de la vérité : la pensée de la pensée. Les mathématiciens ignorent par structure qu'ils sont les seuls ontologues légitimes.
De même, les implications ontologiques de cette subtilissime construction soustractiviste aboutissent à ceci que l'événement n'est pas. L'événement est "ce qui n'est pas l'être". Est-ce un nouveau nihilisme ? Ou est-ce plus contourné ? N'est-ce pas plutôt une manoeuvre militante ? S'agit-il en réalité et d'établir les conditions de possibilité et d'orchestrer sur le Kampfplatz le surgissement des corsaires ?
Il suffira pour répondre de rappeler que l'anti-philosophe ne se sent tenu à aucune ontologie. Cette leçon du maître ès inconscients, Badiou l'a retenue.
00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
05/02/2005
Il n'y a pas de sujet
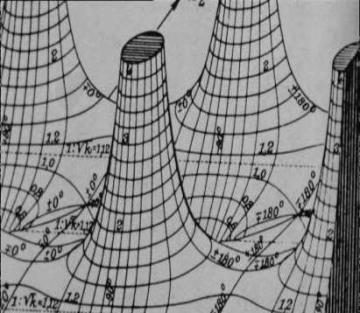
La critique du sujet est un topos de la philosophie post-cartésienne, et ce dès les Objections aux Méditations Métaphysiques. Cependant, après l’épisode humien, celle-ci se généralise à la suite de Mach et de Nietzsche, auteurs qui donneront naissance à deux traditions philosophiques par ailleurs divergentes. De même, la psychanalyse modifie profondément la notion de sujet en mettant en exergue l’instance de l’inconscient ; Heidegger, quant à lui, rompant ainsi avec la phénoménologie husserlienne fondée sur un cogito amendé hérité de Kant, substitue le Dasein au sujet classique et transcendantal.
La liste des détracteurs de la subjectivité au XXème siècle est fort longue. Mais, cette notion, bien que modifiée parfois drastiquement, n’est jamais abandonnée. Au contraire, Deleuze, affirme en 1988 dans l’entretien Signes et événements qu’ « il n’y a pas de sujet », « il n’y a que des processus qui peuvent être d’unification, de subjectivation, de rationalisation, mais rien de plus. »
En effet, dès Empirisme et Subjectivité, Deleuze cherche, à travers l’œuvre de Hume, si la subjectivité se constitue dans le donné, dans le « flux du sensible ». Il apparaît en fait que la critique de la subjectivité constitue un fil rouge de l’œuvre deleuzienne ; cette question croise en effet ses problèmes et ses concepts majeurs et s’avère comme l’une de leur condition de possibilité : désir, multiplicité, CsO, « en finir avec le jugement », plan d’immanence et champ transcendantal… Cette critique ne se réduit donc pas à une simple mise en question du sujet. Deleuze promeut un autre type d’individuation, « l’individuation non personnelle », les heccéités et singularités. La construction de ces concepts croise et enrichit les problématiques d’auteurs tels que Foucault, Klossowski, Blanchot ou Artaud entre autres. Avec le concours de Guattari, elle s’oppose en outre à la psychanalyse afin de substituer un inconscient machinique à l’inconscient scénique. Enfin, les critiques actuelles de Badiou – qui ne renonce pas à une conception non phénoménologique du sujet inspirée de Lacan et confrontée à la théorie mathématique post-cantorienne des ensembles – semblent les plus pertinentes même si elles achoppent sur l’ontologie et la question de la transcendance.
Ainsi, en ce sens, Deleuze prolonge-t-il le geste nietzschéen. La mort de Dieu a pour corrélat celle de l’Homme. Et si avec Nietzsche l’athéisme devient un « acquis de la philosophie», avec Deleuze c’est dorénavant le cas pour l’a(nti)-humanisme.
00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
03/02/2005
Le Mat du fou

Le paranoïaque joue un jeu fini (c’est-à-dire un jeu qu’on joue pour gagner) contre le monde. Son adversaire d’occasion finit par percevoir les règles du jeu propres au paranoïaque qui lui fait face. Ce dernier se méfie de tout sauf de cela. C’est son erreur fatale : il met son point aveugle en acte.
Le schizoïde (on nomme schizoïdie la schizophrénie en tant que processus) joue en parallèle de multiples jeux finis dont les règles diffèrent selon les paranoïaques singuliers qui lui font face. Mais le schizoïde joue également une partie contre lui-même. Cette partie est, à la différence des autres, une partie sans règles (ou plus exactement une partie dont les règles varient à chaque coup) où tous les codes sont successivement essayés. Il s’agit de continuer à jouer : c’est un jeu infini. Cette partie contre lui-même est une mince ouverture par laquelle le monde est perçu d’autant plus intensément qu'elle est étroite ; le réel s'y projette certes totalement, mais concentré, comprimé, replié.
Le processus schizophrénique a deux issues : la folie ou l’œuvre.
Deux folies sont possibles. D’abord, la schizophrénie "psychiatrique" : le schizophrène a perdu toutes les parties, sauf celle (évidemment) qu’il joue contre lui-même et qui continuera indéfiniment jusqu’à un impossible épuisement des codes. Ou bien : la paranoïa. Dans ce cas, le schizoïde a fixé des règles déterminées à la partie qu’il jouait contre lui-même. Il a transformé son jeu infini en jeu fini. Lesdites règles sont celles du jeu qu’il a perdu contre un paranoïaque, paranoïaque qui fait désormais office de Surmoi, de maître inconscient. L’inconscient devient donc maître. La partie qu’il jouait contre lui-même, il la jouera contre le monde ; ce sera désormais la seule partie qu’il jouera. Chacun des adversaires qu’il rencontrera sera le pharmakon, le bouc émissaire. A son tour, le schizoïde est devenu paranoïaque. Contagion.
La seconde issue est celle de l’œuvre. Le schizoïde devient créateur ; il entre dans un processus de création continue de codes, mais de codes adaptés aux exigences du réel. Il trace ainsi des cribles sur le chaos fluctuant et lui donne une consistance chaque fois nouvelle. Comment l’œuvre s’est-elle engagée dans ce cas ?
Il fallait au schizoïde refuser de concéder le pat et d’accepter de faire le mat nécessaire. Il fallait jouer pour gagner une partie finie face à un paranoïaque. Mais pas n’importe laquelle. Il fallait saisir quelle était la partie dont dérivaient toutes les autres. Et cette partie, ce jeu fini singulier, c’était la partie qui, chronologiquement, fut engagée la première et dans laquelle le schizoïde avait les noirs.
00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
02/02/2005
Clarification de Bergson par lui-même
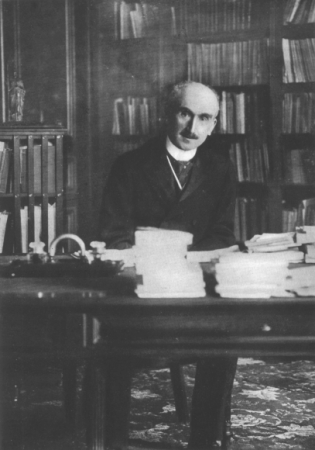 A la suite de plusieurs commentaires sur la précédente note, je crois adéquat de laisser ici la parole à Bergson qui, après Durée et simultanéité (1922), dans son ouvrage La pensée et le mouvant (1934), écrit ceci :
A la suite de plusieurs commentaires sur la précédente note, je crois adéquat de laisser ici la parole à Bergson qui, après Durée et simultanéité (1922), dans son ouvrage La pensée et le mouvant (1934), écrit ceci :« Ajoutons, au sujet de la théorie de la Relativité, qu'on ne saurait l'invoquer ni pour ni contre la métaphysique exposée dans nos différents travaux, métaphysique qui a pour centre l'expérience de la durée avec la constation d'un certain rapport entre cette durée et l'espace employé à la mesurer. Pour poser un problème, le physicien, relativiste ou non, prend ses mesures dans ce Temps-là, qui est le nôtre, qui est celui de tout le monde. S'il résout le problème, c'est dans le même Temps, dans le Temps de tout le monde, qu'il vérifiera sa solution. Quant au temps amalgamé avec l'Espace, quatrième dimension d'un Espace-Temps, il n'a d'existence que dans l'intervalle entre la position du problème et sa solution, c'est-à-dire dans les calculs, c'est-à-dire enfin sur le papier. La conception relativiste n'en a pas moins une importance capitale, en raison du secours qu'elle apporte à la physique mathématique. Mais purement mathématique est la réalité de son Espace-Temps, et l'on ne saurait l'ériger en réalité métaphysique, ou "réalité" tout court, sans attribuer à ce dernier mot une signification nouvelle.
On appelle en effet de ce nom, le plus souvent, ce qui est donné dans une expérience, ou ce qui pourrait l'être : est réel ce qui est constaté ou constatable. Or il est de l'essence même de l'Espace-Temps de ne pas pouvoir être perçu. On ne saurait y être placé, ou s'y placer, puisque le système de référence que l'on adopte est, par définition, un système immobile, que dans ce système Espace et Temps sont distincts, et que le physicien est effectivement existant, prenant effectivement des mesures, est celui qui occupe ce système : tous les autres physiciens, censés adopter d'autres systèmes, ne sont plus alors que des physiciens par lui imaginés. Nous avons jadis consacré un livre à la démonstration de ces différents points.
Nous ne pouvons le résumer dans une simple note. Mais comme le livre a souvent été mal compris, nous croyons devoir reproduire ici le passage essentiel d'un article où nous donnions la raison de cette incompréhension. Voici en effet le point qui échappe d'ordinaire à ceux qui, se transportant de la physique à la métaphysique, érigent en réalité, c'est-à-dire en chose perçue ou perceptible, existant avant et après le calcul, un amalgame d'Espace et de Temps qui n'existe que le long du calcul et qui, en dehors du calcul, renoncerait à son essence à l'instant même où l'on prétendrait en constater l'existence.
Il faudrait en effet, disions-nous, commencer par bien voir pourquoi, dans l'hypothèse de la Relativité, il est impossible d'attacher en même temps des observateurs "vivants et conscients" à plusieurs systèmes différents, pourquoi un seul système - celui qui est effectivement adopté comme système de référence - contient des physiciens réels, pourquoi surtout la distinction entre le physicien réel et le physicien représenté comme réel prend une importance capitale dans l'interprétation philosophique de cette théorie, alors que jusqu'ici la philosophie n'avait pas eu à s'en préoccuper dans l'interprétation de la physique. La raison en est pourtant très simple.
Du point de vue de la physique newtonienne par exemple, il y a un système de référence absolument privilégié, un repos absolu et des mouvements absolus. L'univers se compose alors, à tout instant, de points matériels dont les uns sont immobiles et les autres animés de mouvements parfaitement déterminés. Cet univers se trouve donc avoir en lui-même, dans l'Espace et le Temps, une figure concrète qui ne dépend pas du point de vue où le physicien se place : tous les physiciens, à quelque système mobile qu'ils appartiennent, se reporte par la pensée au système de référence privilégié et attribue à l'univers la figure qu'on lui trouverait en le percevant ainsi dans l'absolu. Si donc le physicien par excellence est celui qui habite le système privilégié, il n'y a donc pas ici à établir une distinction radicale entre ce physicien et les autres, puisque les autres procèdent comme s'ils étaient à sa place.
Mais, dans la théorie de la Relativité, il n'y a plus de système privilégié. Tous les systèmes se valent. N'importe lequel d'entre eux peut s'ériger en système de référence, dès lors immobile. Par rapport à ce système de référence, tous les points matériels de l'univers vont encore se trouver les uns immobiles, les autres animés de mouvements déterminés ; mais ce ne sera plus que par rapport à ce système. Adoptez-en un autre : l'immobile va se mouvoir, le mouvant s'immobiliser ou changer de vitesse ; la figure concrète de l'univers aura radicalement changé. Pourtant l'univers ne saurait avoir à vos yeux ces deux figures en même temps ; le même point matériel ne peut pas être imaginé par vous, ou conçu, en même temps immobile et mouvant. Il faut donc choisir ; et du moment que vous avez choisi telle ou telle figure déterminée, vous érigez en physicien vivant et conscient, réellement percevant, le physicien attaché au système de référence d'où l'univers prend cette figure : les autres physiciens tels qu'ils apparaissent dans la figure d'univers ainsi choisie, sont alors des physiciens virtuels, simplement conçus comme physiciens par le physicien réel. Si vous conférez à l'un d'eux (en tant que physicien) une réalité, si vous le supposez percevant, agissant, mesurant, son système est un système de référence non plus virtuel, non plus simplement conçu comme pouvant devenir un système réel, mais bien un système de référence réel ; il est donc immobile, c'est à une nouvelle figure du monde que vous avez affaire ; et le physicien réel de tout à l'heure n'est plus qu'un physicien représenté.
M. Langevin a exprimé en termes définitifs l'essence même de la théorie de la Relativité quand il a écrit que "le principe de la Relativité, sous sa forme restreinte comme sous sa forme plus générale, n'est au fond que l'affirmation de l'existence d'une réalité indépendante des systèmes de référence, en mouvement les uns par rapport aux autres, à partir desquels nous en observons des perspectives changeantes. Cet univers a des lois auxquelles l'emploi de coordonnées permet de donner une forme analytique indépendante du système de référence, bien que les coordonnées individuelles de chaque événement en dépendent, mais qu'il est possible d'exprimer sous forme intrinsèque, comme la géométrie le fait pour l'espace, grâce à l'introduction d'éléments invariants d'un langage approprié". En d'autres termes, l'univers de la Relativité est un univers aussi réel, aussi indépendant de notre esprit, aussi absolument existant que celui de Newton et du commun des hommes : seulement, tandis que pour le commun des hommes et même encore pour Newton cet univers un ensemble de choses (même si la physique se borne à étudier des relations entre des choses), l'univers d'Einstein n'est plus qu'un ensemble de relations. Les éléments invariants que l'on tient ici pour constitutifs de la réalité sont des expressions où entrent des paramètres qui sont tout ce qu'on voudra, qui ne représentent pas plus du Temps ou de l'Espace que n'importe quoi, puisque c'est la relation entre eux qui existera seule aux yeux de la science, puisqu'il n'y a plus de Temps ni d'Espace s'il n'y a plus de choses, si l'univers n'a pas de figure. Pour rétablir des choses, et par conséquent le Temps et l'Espace (comme on le fait nécessairement chaque fois qu'on veut être renseigné sur un événement physique déterminé, perçu en des points déterminés de l'Espace et du Temps), force est bien de restituer au monde une figure ; mais c'est qu'on aura choisi un point de vue, adopté un système de référence. Le système qu'on a choisi devient d'ailleurs, par là même, le système central. La théorie de la Relativité a précisément pour essence de nous garantir que l'expression mathématique du monde que nous trouvons de ce point de vue arbitrairement choisi sera identique, si nous nous conformons aux règles qu'elle a posées, à celle que nous aurions trouvée en nous plaçant à n'importe quel autre point de vue. Ne retenez que cette expression mathématique, il n'y a pas plus de Temps que n'importe quoi. Restaurez le Temps, vous rétablissez les choses, mais vous avez choisi un système de référence et le physicien qui y sera attaché. Il ne peut y en avoir d'autre pour le moment, quoique tout autre eût pu être choisi. »
Edition du Centenaire, p. 1280, n. 1
22:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
01/02/2005
Combien de temps ?

C'est sans relâche et conformément à sa doctrine selon laquelle un philosophe n'a au fond qu'une unique intuition fondamentale que Bergson aura tenté de défendre la durée. En particulier, selon lui, la science se fait du temps une conception erronée. Par un tropisme de l'intelligence, la pensée scientifique opère sa spatialisation et le rend ainsi homogène à l'étendue déqualifée, géométrique et donc en dernière instance cartésienne.
La théorie einsteinienne de la relativité constitue bien entendu pour Bergson le parangon de cette méconnaissance. Elle achève de mélanger et de confondre temps et espace. En effet, la science pré-relativiste assimilait certes ces deux notions ; mais si le temps était bien une quatrième dimension de l'espace, il n'en était pas moins séparé par une distinctio realis, c'est-à-dire qu'il restait une variable indépendante. Avec la relativité, tout change, et le « mixte mal analysé » de temps et d'espace s'introduit cette fois explicitement dans les calculs pour exprimer l'invariance de la distance.
Où réside ici le différend entre le philosophe et le scientifique ?
Einstein considère deux systèmes S et S' "en état de déplacement réciproque et uniforme" et dans lesquels le temps est différent. Bergson demande simplement : qu'est-ce que deux temps qui diffèrent ? Qualitativement, ils sont identiques puisque un changement de référentiel permet de les permuter. Y aurait-il donc un deuxième temps qui n'est ni celui de S ni celui de S' ? On pourrait arguer qu'il s'agirait là du temps vécu de S' tel qu'un observateur situé en S le conçoit.
Non.
« Sans doute Pierre [en S] colle sur ce Temps une étiquette au nom de Paul [en S'] ; mais s'il se représentait Paul conscient, vivant sa propre durée et la mesurant, par là même il verrait Paul prendre son propre système pour système de référence, et se placer alors dans ce Temps unique, intérieur à chaque système, dont nous venons de parler : par là même aussi, d'ailleurs, Pierre ferait provisoirement abandon de son système de référence, et par conséquent de son existence comme physicien, et par conséquent aussi de sa conscience ; Pierre ne se verrait plus lui-même que comme une vision de Paul. Mais quand Pierre attribue au système de Paul un Temps ralenti, il n'envisage plus dans Paul un physicien, ni même un être conscient, ni même un être : il vide de son intérieur conscient et vivant l'image visuelle de Paul, ne retenant du personnage que son enveloppe extérieure (elle seule en effet intéresse la physique) [...] » Bergson, Durée et simultanéité, PUF, coll. "Quadrige", p.74.
Une abstraction, une fiction ou un symbole sont subrepticement mis en lieu et place d'une réalité vivable et vécue. Cette science est atteinte d'un idéalisme en phase terminale qui a pour nom solipsisme. Le physicien, drapé dans une marmoréenne objectivité, s'avère en réalité « un observateur fantasmatique ».
« Mais les autres hommes ne seront plus que référés ; ils ne pourront maintenant être, pour le physicien, que des marionnettes vides. Que si Pierre leur concédait une âme, il perdrait aussitôt la sienne ; de référés ils seraient devenus référants ; ils seraient physiciens, et Pierre aurait à se faire marionnettes à son tour. [...] La pluralité des Temps se dessine au moment précis où il n'y a plus qu'un seul homme ou un seul groupe à vivre du temps. Ce Temps-là devient alors seul réel : c'est le Temps réel [...], mais accaparé par l'homme ou le groupe qui s'est érigé en physicien. Tous les autres hommes, devenus fantoches à partir de ce moment, évoluent désormais dans des Temps que le physicien se représente et qui ne sauraient plus être du Temps réel, n'étant pas vécus et ne pouvant pas l'être. Imaginaires, on en imaginera naturellement autant qu'on voudra. » Ibid. pp. 83-84.
La relativité, on le voit, édicte un singulier absolu.
Confondant les mots et les choses, le symbolique et le réel, la technique et la pensée, le psittacisme universitaire n'en continue pas moins sa litanie : Bergson n'a rien compris à Einstein puisque la relativité fonctionne. Mais savoir lire philosophiquement, peut-être est-ce trop demander. Cela requiert en effet un peu plus que de la logique.
16:15 | Lien permanent | Commentaires (0)



