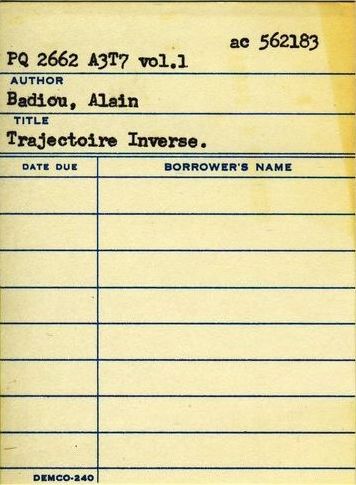24/09/2007
Ter
00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
20/09/2007
Principium individuationis
« Mon arrachement à Autrui, c'est-à-dire mon Moi-même, est par structure essentielle assomption comme mien de ce moi qu'autrui refuse ; il n'est même que cela. » (Sartre)
*
« Tel est l’empirisme des modernes. » (Valéry)

L'individu, étymologiquement, c'est ce qui ne se divise pas. On pourrait préciser, à la manière d'un Bergson définissant, quant à lui, la multiplicité intensive, en assertant que l'individu est ce qui ne se divise pas « sans changer de nature ».
À ce propos, Merleau-Ponty narrait à qui voulait l'entendre une anecdote personnelle. Alors qu'un jour il était arrivé en retard au cinéma, l'ouvreuse, contre toute attente, se mit à contrevenir crânement au droit naturel du philosophe français. Désirant s'installer dans une rangée de fauteuils où il aurait à « déranger » une dizaine de personnes, l'employée lui demanda fermement de plutôt choisir un autre siège, opération qui n'entraînerait finalement la gêne que d'un unique spectateur, outre, bien entendu, la sienne. Agacé, l'éminent phénoménologue, professeur de son état, lui rétorqua immédiatement : « Mais, pour chacun, c'est tout pareil ! ». Notons tout de suite que nous ferons ici bon marché de toute explication différencialiste qui invoquerait, par exemple, le sexe (tout adventice, mais ici, incontestablement féminin) de cet « esclave salarié », syntagme dont d'aucuns, d'ailleurs, pourraient être tentés de l'affubler.
Tout au contraire, afin d'exemplifier la présence rampante du Socius au sein du quidam, ou même, laissant ainsi brièvement poser l'épistémologue naturalisant, ou pis, biologisant, celle de l'espèce en personne, nous en appellerons à une saillie borgésienne, qui s'oppose mâlement au sens commun (réquisit, rappelons-le, du « bon sens » lui-même) de tout un chacun. Statistiquement, du moins. Le bibliothécaire aveugle, rejeton délicat d'un psychologue argentin, nous propose donc l'élégante pensée que voici.
Que penser, toutefois, de cette incongrue pierre de touche, ainsi que de ses conséquences philosophiques et, en particulier, éthiques ? Pour faire court, le « pasteur des hommes », selon l'expression de Platon (ou d'un penseur apocryphe), et notamment les divers avatars contemporains de ce bon berger, pourtant majoritairement inavertis du kantisme, doivent-ils finalement être considérés, ceteris paribus, comme d'autant plus « moraux » ?
Bref, usant pour cela outrageusement (nous sommes, il est vrai, coutumier du fait) de l'enthymème, pouvons-nous en déduire tout de go, comme corollaire, que le pur individualisme, pour être cohérent (et même, disons-le en coda, conséquent), se doit d'être non seulement exempt de tout altruisme, mais donc aussi, stricto sensu, d'égoïsme ?
Thomas Duzer
00:00 | Lien permanent | Commentaires (6)
18/09/2007
L'Énigme du Réalisme (6)
par Ray Brassier
Si la pensée ne peut pas plus longtemps prétendre s’exempter de la réalité qu’elle pense, et si le réel ne peut plus être directement calqué sur l’être, ou l’idéel sur la pensée, alors la pensée elle-même doit être réintégrée dans une enquête spéculative sur la nature de la réalité. Ainsi, la question centrale soulevée par le réalisme spéculatif de Meillassoux se transforme. Est-ce que le principe de factualité, qui déclare que « tout ce qui existe est nécessairement contingent », s’inclut lui-même dans ce qu’il désigne comme « tout » ? A l’instar de Badiou, Meillassoux considère que Cantor a définitivement pulvérisé le concept de « totalité », et donc que cette dernière est désormais dénuée de pertinence ontologique. Mais nous n’avons pas à supposer une totalisation erronée de l’existence pour nous demander si oui ou non la pensée selon laquelle tout est nécessairement contingent est elle-même nécessairement contingente. Au contraire, nous ne faisons que supposer que la pensée est un fait contingent comme un autre. Ce que nous devons refuser, cependant, est l’assertion qui dit qu’il est nécessaire d’exempter la pensée selon laquelle « tout est nécessairement contingent » du fait « existentiel » que tout est contingent au motif d’un abîme transcendantal séparant la pensée de l’être. Une fois que le recours à cette division transcendantale a été exclu, l’on est obligé de prendre en considération ce qui s’ensuit de l’assomption de ce principe auto-référent. Plus précisément, nous devons déterminer si la vérité du principe, et a fortiori la victoire de Meillassoux sur le corrélationisme, entraîne ou non son auto-référence. Ici, nous devons distinguer la contingence de l’existence de la pensée, qui ne produit aucun paradoxe, et la contingence de la vérité de la pensée, qui, elle, en provoque. Deux possibilités distinctes peuvent être envisagées, possibilités liée au caractère, auto-référent au non, de la pensée. D’abord, interrogeons-nous sur les conséquences que produirait le fait qu’elle soit auto-référente. Si la pensée existe, elle doit être contingente. Mais si elle est contingente, alors sa négation pourrait également exister : « Tout n’est pas nécessairement contingent ». Cependant, afin que la pensée soit en mesure d’exclure la possibilité de la vérité de sa négation, sa vérité doit être nécessaire, ce qui signifie que la pensée doit exister nécessairement. Mais si elle existe nécessairement, alors tout ce qui existe n’est pas nécessairement contingent ; il y a au moins une chose qui ne l’est pas, à savoir la pensée elle-même. Si donc la pensée réfère à elle-même, elle nécessite l’existence de sa propre négation ; mais pour refuser la vérité possible de sa négation, il lui faut affirmer sa propre vérité nécessaire, et par conséquent se contredire elle-même une fois de plus. Que se passe-t-il si l’on prend pour hypothèse que la pensée ne réfère pas à elle-même ? Alors il y a quelque chose qui est nécessaire, mais qui n’est pas inclus dans la rubrique de l’existence. La réalité n’est « pas tout » parce que la pensée que « tout est nécessairement contingent » est une idéalité qui s’exempte de la réalité qu’elle désigne. Dans ce cas alors, non seulement cette exemption même devient nécessaire pour l’idéalité intelligible de la pensée selon laquelle « tout est nécessairement contingent », mais en plus, l’intelligibilité de la réalité conçue comme l’existence nécessaire de la contingence devient dépendante de la cohérence d’une pensée dont l’exemption par rapport à la réalité est nécessaire pour penser cette dernière comme nécessairement contingente. La tentative de dispenser l’idéel du réel menace donc de reconstituer une fois de plus le cercle corrélationiste. Enfin, considérons la possibilité que la contingence nécessaire de l’existence ne dépende pas de la vérité de la pensée que « tout est nécessairement contingent ». Si tout est nécessairement contingent, et ce, que la pensée selon laquelle « tout est nécessairement » contingent » soit vraie ou non, alors tout pourrait être nécessairement contingent même si nous n’avons aucun moyen de penser la vérité de cette pensée de manière cohérente. Mais ce serait là réintroduire la possibilité d’une discordance radicale entre la cohérence de la pensée et la manière dont le monde est en lui-même. Toute hypothèse irrationnelle à propos de ce dernier devient possible et le corrélationisme fort surgit une fois encore.
Quels que soient leurs défauts liés à leur manque de rigueur formelle, ces conjectures semblent mettre en évidence un dilemme fondamental au sein du projet de Meillassoux. S’il accepte – et nous croyons qu’il le doit – que la pensée fait partie de l’être comme la deuxième implication spéculative fondamentale de la rationalité scientifique après celle de la diachronicité, alors la portée universelle du principe de factualité génère un paradoxe par lequel il se contredit lui-même : l’assertion que tout est nécessairement contingent n’est vraie que si cette pensée existe nécessairement. Autrement, si Meillassoux décide de maintenir le statut exceptionnel de la pensée vis-à-vis de l’être, il semble alors qu’il compromette son exigence de diachronicité, puisque la réalité intelligible de l’être contingent est rendue dépendante de la cohérence idéelle du principe de factualité. Et en effet, l’appel à l’intuition intellectuelle dans la formulation de ce principe semble déjà supposer une sorte de réciprocité entre la pensée et l’être.
Comme on pouvait s’y attendre, ces deux critiques – à savoir, que l’intuition intellectuelle rétablit une corrélation entre la pensée et l’être, et que le principe de factualité engendre un paradoxe – ont donné lieu à des réponses particulièrement précises de la part de Meillassoux. Dans une communication personnelle, Meillassoux a expliqué pourquoi il croit pouvoir parer ces deux objections. Pour Meillassoux, le principe de factualité est conçu pour satisfaire à deux exigences. D’abord, l’exigence rationaliste fondamentale que la réalité est parfaitement intelligible conceptuellement. C’est un rejet de la notion typiquement religieuse selon laquelle l’existence recèle une espèce de mystère qui transcende à jamais l’intellection. Deuxièmement, la simple exigence matérialiste que l’être, bien que parfaitement intelligible, demeure irréductible à la pensée. Meillassoux insiste sur le fait que l’assertion déclarant que tout est nécessairement contingent satisfait à ces deux critères.
« L’être est pensé intégralement dans la mesure où il est sans raison ; et l’être qui est pensé de cette manière est conçu comme excédant la pensée de toutes parts parce qu’il se révèle capable de produire et de détruire la pensée ainsi que tout autre espèce d’entité. En tant qu’acte factuel produit par un être pensant également factuel, l’intuition intellectuelle de la facticité est parfaitement susceptible d’être détruite, mais pas celle que, même pour un instant, il aura pensé en tant que vérité éternelle qui légitime son nom, à savoir, qu’il est tout aussi périssable que tout ce qui existe. […] Donc, c'est parce que l’être émerge sans raison qu’il excède de toutes parts tout ce que la pensée peut décrire de sa production factuelle ; néanmoins, il ne contient rien qui soit incompréhensible pour la pensée car l’excès de l’être sur la pensée indique seulement que la raison est à jamais absente de l’être, et non quelque pouvoir énigmatique. » (1)
Ces remarques préfigurent déjà la récusation par Meillassoux de la seconde objection, à savoir que s’il est appliqué à lui-même, le principe de factualité devient contradictoire. Meillassoux soutient que ce paradoxe peut être évité en distinguant soigneusement la référence du principe de son existence (factuelle). Ainsi, même si cette dernière est bien contingente, et donc susceptible d’être comme de n’être pas, la référence du principe est strictement nécessaire, et c’est en fait la nécessité éternelle de la référence du principe qui garantit la contingence perpétuelle de l’existence du principe.
« On pourrait alors dire que le principe, en tant qu’il est pensé en réalité est factuel, et donc contingent. Mais ce qui n’est pas contingent, c’est la référence de ce principe, c’est-à-dire la facticité en tant que telle pour autant qu’elle est nécessaire. Et c’est parce que cette facticité est nécessaire que le principe, pour autant qu’il est – en fait – proféré et pour autant qu’il sera ou aura été pensé par quelque entité – quels que soient le moment ou les circonstances – c’est pour cette raison que le principe sera toujours vrai au moment où il est posé ou pensé. Ce qui est contingent, c’est que le principe, en tant qu’énoncé doué de sens, soit, en fait, pensé ; mais ce qui n’est pas contingent, c’est qu’il est vrai pour autant qu’il est – en fait – pensé en lieu et un moment donnés – qu’importe où et quand. Par conséquent, il n’y a pas de paradoxe tant que domaine d’application du principe est précisément réservé aux entités dans leur être. » (2)
Ici, la distinction opératoire cruciale est faite entre la nécessité de la contingence en tant que référence de la pensée et la contingence de l’existence (factuelle) de la pensée que tout est nécessairement contingent. La question est alors : de quelle manière Meillassoux propose-t-il d’expliquer cette séparation entre l’existence contingente de la pensée et l’existence nécessaire de sa référence ? Manifestement, cette séparation est faite pour sauvegarder et la cohérence du principe, et le primat matérialiste du réel sur l’idéel, en instaurant une différentiation stricte entre la pensée et la réalité. Mais étant donné que, pour Meillassoux, la prise de la pensée sur la réalité est garantie par l’intuition intellectuelle, il s’ensuit que ce doit être aussi cette dernière qui rende compte de cette distinction entre la pensée et la référence. Par conséquent, il semblerait que ce soit dans et par l’intuition intellectuelle de l’absolue contingence que la contingence de la pensée est séparée de la nécessité de son référent. Tout, alors, dépend de la manière dont Meillassoux comprend le terme d’ « intuition intellectuelle ».
Manifestement, il ne peut pas employer ce terme dans son acception kantienne, puisque, pour Kant, l’intuition intellectuelle crée son propre objet de manière active, contrairement à l’intuition sensible, qui reçoit passivement un objet existant indépendamment. Selon Kant, seule la compréhension intuitive d’un intellect archétypal (intellectus archetypus) dépourvu de sensibilité – telle que celle de Dieu – possède le pouvoir de créer son objet ; en ce qui concerne notre compréhension discursive, médiatisée par la sensibilité, c’est la synthèse du concept et de l’intuition qui produit la relation cognitive entre la pensée et son objet. Meillassoux rejette manifestement l’explication représentationaliste de la relation entre l’esprit et le monde, de la même manière qu’il doit refuser l’appel de la phénoménologie à une corrélation intentionnelle entre la pensée et la référence. Il est déjà loin d’être évident de savoir quelle théorie plausible de l’intuition intellectuelle pourrait simultanément assurer la scission entre la contingence de la pensée et la nécessité de son référent – que Meillassoux considère comme suffisante pour empêcher la contradiction – tout en évitant la corrélation représentationnelle et intentionnelle aussi bien qu’en renonçant à la production de son objet par l’intellect archétypal (puisque la création de son objet par l’intellect est clairement incompatible avec tout engagement matérialiste). Même si Meillassoux soutient que le paradoxe de l’absolue contingence peut être évité en restreignant le domaine de référence du principe aux « entités dans leur être », il n’explique pas comment il se propose de faire respecter la démarcation rigide entre l’intension du principe, effectuée de manière contingente, et ce qu’il estime être son extension « éternellement » nécessaire.
La référence, bien entendu, est intimement liée à la « vérité », mais bien que Meillassoux déclare que la vérité du principe est garantie par son référent ontologique, cette liaison est tout sauf sémantiquement transparente, puisque l’extension de l’expression « absolue contingence » n’est pas plus claire que le terme « être ». Le préalable habituel des conceptions réalistes de la vérité est une explication extra-théorique de la relation entre intension et extension, mais la tentative de Meillassoux d’interpréter celle-ci en terme d’intuition intellectuelle rend extrêmement difficile de voir comment elle pourrait être autre qu’intra-théorique. En effet, on ne saisit pas clairement comment la référence d’ « absolue contingence » pourrait être rendue intelligible autrement que dans un registre purement conceptuel. Par conséquent, Meillassoux nous présente un cas dans lequel la détermination de l’extension, ou « vérité » , demeure entièrement dépendante d’une intension stipulée conceptuellement, ou « sens » - la référence d’ « absolue contingence » est exclusivement déterminée par le sens de la pensée contingente selon laquelle « tout ce qui est, est absolument contingent ». Mais si la seule manière d’assurer la séparation entre l’idéalité (existant de manière contingente) du sens et la réalité (nécessairement existante) de la référence est de rendre la conceptualité constitutive de l’objectivité, alors l’absolutisation de la référence non-corrélationnelle est réussie au prix d’une absolutisation d’un sens conceptuel qui viole l’exigence matérialiste selon laquelle l’être n’est pas réductible à la pensée. Loin de réconcilier rationalisme et matérialisme, le principe de factualité, au moins dans cette version, continue de subordonner la réalité extra-conceptuelle au concept d’absolue contingence.
Bien que la victoire spéculative de Meillassoux sur le corrélationisme s’attache à déployer les armes les plus puissantes de ce dernier contre elle – ainsi que nous l’avons vu avec le principe de factualité lui-même – la distinction entre le réel et l’idéel fait partie de l’héritage corrélationiste, héritage qui ne peut pas être mobilisé à son encontre sans que soit procédé à sa décontamination. Le corrélationisme n’assure la division transcendantale entre le réel et l’idéel qu’au prix de faire de l’être le corrélat de la pensée. Meillassoux a raison de soutenir qu’il est nécessaire de traverser le corrélationisme afin de le vaincre, et à cet égard il nous faut suivre son conseil et trouver un moyen de déployer la distinction entre réel et idéel contre le corrélationisme lui-même. Mais précisément se révèle là un problème spéculatif fondamental : peut-on penser la disjonction diachronique entre le réel et l’idéel tout en évitant le recours à une division transcendantale entre la pensée et l’être ?
(1) Communication personnelle, 8/9/2006.
(2) Ibid.
(FIN)
N.B. :
L'intégralité de la traduction de cet article est disponible au format .pdf dans la rubrique 'Traductions', en haut de la colonne de gauche.
01:10 | Lien permanent | Commentaires (2)
10/09/2007
L'Énigme du Réalisme (5)
par Ray Brassier
5. LE PARADOXE DE L'ABSOLUE CONTINGENCE
Esquivant de façon frappante toute la problématique de la représentation, Meillassoux déclare hardiment son intention de remettre l’intuition intellectuelle à l’honneur :
« [I]l nous faut projeter l’irraison dans la chose même, et découvrir en notre saisie de la facticité la véritable intuition intellectuelle de l’absolu. Intuition, car c’est bien à même ce qui est que nous découvrons une contingence sans autre borne qu’elle-même – intellectuelle, car cette contingence n’est rien de visible, rien de perceptible en la chose : seule la pensée qui accède comme au Chaos qui sous-tend les continuités apparentes du phénomène. » (1)
Le déploiement de cette variété supposément non-métaphysique d’intuition intellectuelle contourne la distinction critique de Kant entre le phénomène connaissable et la chose-en-soi inconnaissable – entre la réalité à laquelle nous sommes reliés à travers la représentation et la réalité en tant qu’elle existe indépendamment de notre représentation à elle – et réhabilite la distinction entre qualités premières et secondes ; les qualités premières étant intuitionnables mathématiquement comme les traits des choses en elles-mêmes ; les qualités secondes se trouvant être les caractéristiques phénoménologiques de notre relation aux choses (2). Cette remise à l’honneur de l’intuition intellectuelle est l’un des aspects du contournement par Meillassoux de la délimitation critique kantienne des possibilités de la raison. L’intuition intellectuelle nous procure désormais un accès direct à un domaine de pure possibilité coextensif à un temps absolu. Kant déplaçait l’hypostase métaphysique vers la possibilité logique en subordonnant cette dernière au domaine de la possibilité réelle circonscrite par la relation entre la raison et la sensibilité. Le temps en tant que synthèse transcendantale fonde la structure de la possibilité (3). Mais l’absolutisation de la contingence par Meillassoux absolutise effectivement le domaine a priori de la pure possibilité logique et délie celui de l’intelligibilité mathématique de la sensibilité. Cette séparation du possible d’avec le sensible est gagé par la structure chaotique du temps absolu. Là où les liens de la possibilité réelle restent circonscrits par le corrélationnel a priori, l’intuition intellectuelle révèle un domaine de possibilité absolue dont l’unique contrainte est la non-contradiction. De plus, là où la possibilité réelle est subsumée par le temps comme forme de la subjectivité transcendantale, la possibilité absolue désigne un temps qui ne dépend plus de la cohérence d’une relation subjective à la réalité ou à la corrélation entre la pensée et l’être ; une diachronicité qui, pour Meillassoux, est implicite dans la dimension ancestrale de l’être révélée par la science moderne. En ratifiant la diachronicité de la pensée et de l’être, la science moderne expose la contingence essentielle de la pensée : bien que la pensée nécessite l’être, l’être ne requiert pas la pensée.
La question, alors, est de savoir si la remise à l’honneur de l’intuition intellectuelle par Meillassoux ne risque pas de compromettre cette asymétrie même qu’il considère comme l’apport spéculatif de la science. De la même manière, il se peut que l’hypothèse galiléenne présente des ramifications relatives à la mathématisation de la pensée qui vicieraient également l’appel de Meillassoux à l’intuition intellectuelle. Afin de considérer ces questions, nous devons examiner la distinction qu’invoque Meillassoux dans le but d’écarter l’idéalisme. Il s’agit de la distinction entre la réalité des phénomènes ancestraux et l’idéalité de l’énoncé ancestral. C’est sur la base de cette distinction que Meillassoux, à l’instar de Badiou, cherche à prendre ses distances vis-à-vis de la thèse pythagoricienne selon laquelle l’être est mathématique :
« [O]n soutiendra que les énoncés portant sur l’accrétion qui sont formulables en termes mathématiques désignent quant à eux des propriétés effectives de l’événement en question (sa date, sa durée, son extension), lors même qu’aucun observateur n’était présent pour en faire l’expérience directe. Par là, on soutiendrait une thèse cartésienne sur la matière, mais non pas, remarquons-le bien, une thèse pythagoricienne : on ne dirait pas que l’être de l’accrétion est intrinséquement mathématique – que les nombres ou les équations engagées dans les énoncés ancestraux existent en soi. Car il faudrait alors dire que l’accrétion est une réalité aussi idéelle qu’un nombre ou qu’une équation. Les énoncés, d’une façon générale, sont idéels, en tant qu’ils sont une réalité signifiante : mais leurs référents éventuels, eux, ne sont pas nécessairement idéels (le chat sur le paillasson est réel, quoique l’énoncé : « le chat est sur le paillasson » soit idéel). En l’occurrence, nous dirions donc : les référents des énoncés portant sur les dates, volumes, etc. ont existé il y a 4,56 milliards d’années tels que ces énoncés les décrivent – mais non pas ces énoncés mêmes, qui nous sont, quant à eux, contemporains. » (4)
La distinction entre la réalité des phénomènes ancestraux et l’idéalité des énoncés ancestraux est nécessaire si l’on veut soutenir la disjonction ontologique entre le présent corrélationnel et le passé ancestral – et plus précisément la diachronicité que le corrélationisme ne peut pas contenir. Néanmoins, si Meillassoux invoque une telle distinction, il ne peut la réserver à la seule dimension de l’être, puisqu’elle doit appartenir à la pensée aussi bien qu’à l’être. Ainsi, cette distinction seconde entre réel et idéel subdivise-t-elle les deux pôles de la première disjonction entre pensée et être : la pensée possède un aspect réel et un aspect idéel, de la même manière que l’être possède des traits réels et idéels. Manifestement, la diachronicité de l’archifossile ne peut être indexée que par une disjonction entre l’idéalité de l’énoncé ancestral et la réalité du phénomène ancestral, disjonction qui s’avèrera irréductible aux distinctions voisines entre les aspects réels et idéels de la pensée et les traits réels et idéels de l’être, puisque toutes deux restent entièrement englobées par la corrélation entre la pensée et l’être. Le but de la distinction que fait Meillassoux entre réalité physique et idéalité discursive est de dévaloriser la prétention idéaliste qui consiste à affirmer que la réalité du phénomène est épuisée par les énoncés décrivant son idéalisation mathématique. Bien que la réalité du phénomène ancestral puisse être mathématiquement encodée, elle doit transcender sa description mathématique, car sinon, Meillassoux devrait se compter parmi les sectateurs du pythagorisme. Et Meillassoux sait parfaitement que ce dernier n’offre aucune résistance au corrélationisme, puisqu'il pose l’être comme isomorphe à l’idéalité mathématique. La question, ici, semble bien être que la réalité du phénomène ancestral doit être indépendante de son intellection mathématique – l’être ne dépend pas de l’existence des mathématiques. Mais le problème de Meillassoux réside dans l’identification d’un garant spéculatif pour cette distinction entre réalité et idéalité, garant qui serait entièrement indépendant de ce que donne l’idéalisation mathématique du phénomène ancestral au sein de l’énoncé ancestral. Se fier à ce dernier reviendrait à considérer cette distinction spéculative comme une conséquence des procédures de l’épistémologie post-critique, et donc à se trouver confronté à l’injonction de la vérifier ou de la justifier dans le cadre même du cercle du corrélationisme.
La question à laquelle le réalisme spéculatif de Meillassoux se confronte est donc celle-ci : sous quelles conditions la distinction secondaire entre le réel et l’idéel pourrait-elle être intellectuellement intuitionnable sans pour cela réinstituer une corrélation au niveau de la disjonction primaire entre l’être et la pensée ? Rendre cette distinction entre la réalité du phénomène et l’idéalité de son assertion dépendante de l’intuition intellectuelle revient à la maintenir englobée par l’un des pôles de la disjonction primaire, à savoir la pensée, et donc à laisser intact le cercle corrélationiste. De la même manière que nous ne pouvons soutenir que cette disjonction primaire est intellectuellement intuitionnable sans réinscrire l’être au sein du pôle idéal de la disjonction secondaire, nous ne pouvons soutenir que la disjonction secondaire est encodée dans l’énoncé ancestral sans réincorporer le réel dans le pôle noétique de la disjonction primaire. Comment, alors, pouvons-nous garantir que la disjonction entre le réel et l’idéel est indépendante de l’idéalité intelligible des énoncés ancestraux de la science ? L’idéalité de celle-ci ne peut pas être garante de la réalité de celle-là. Et de plus, l’intuition intellectuelle subsume les deux pôles de la disjonction secondaire dans un pôle de la disjonction primaire.
Par conséquent, Meillassoux est contraint à cette difficile position qui consiste à tenter de concilier l’énoncé selon lequel l’être n’est pas mathématique par nature, et celui selon lequel l’être est intrinsèquement accessible à l’intuition intellectuelle. Il ne peut pas soutenir que l’être est mathématique sans sombrer dans un idéalisme pythagoricien ; mais cette rechute dans le pythagorisme n’est exclue qu’au prix de cet idéalisme qui fait de l’être le corrélat de l’intuition intellectuelle. Le problème réside dans la tentative de rendre compatible l’hypothèse galiléo-cartésienne selon laquelle l’être est mathématisable, avec l’insistance sur la disjonction spéculative par laquelle l’être est tenu de subsister indépendamment du fait qu’il est intuitionnable mathématiquement. Une partie de la difficulté est liée au fait que, même si Meillassoux écarte vraisemblablement les conceptions métaphysique et phénoménologique de l’être, qu'il s’agisse d’une substance nécessaire ou d’une présence eidétique, puisque toutes deux sont prises dans le cercle corrélationiste, celui-ci ne nous a pas donné d’alternative non-métaphysique et non-phénoménologique – telle que peut l’être, par exemple, la conception soustractive du vide chez Badiou. Comme ce dernier, Meillassoux récuse la formulation kantienne de cette problématique de l’accès à l’être tout en cherchant à conserver l’autorité de la rationalité scientifique. Néanmoins, contrairement à Badiou, il ne caractérise pas l’ontologie comme une situation au sein de laquelle la présentation de l’être est inscrite soustractivement de manière à éviter toute corrélation directement métaphysique ou phénoménologique entre la pensée et l’être.
Mais, en conséquence, il nous faut expliquer pourquoi – étant donné que la science nous enseigne que l’intellection n’est en aucun cas un trait inéliminable de la réalité, mais simplement un sous-produit contingent de l’histoire de l’évolution, et puisque pour Meillassoux lui-même la réalité ne peut être ni mathématique par nature, ni intelligible nécessairement – l’être devrait être accessible à l’intuition intellectuelle. Dans cette optique, il vaut la peine de noter que l’une des ramifications les plus significatives de l’hypothèse galiléo-cartésienne à propos de la mathématisation de la nature consiste en la tentative récente de déployer les ressources de la modélisation mathématique dans le but de développer une science de la cognition. Il est vrai, celle-ci en est encore à ses débuts ; toutefois, sa maturité promet de se passer du dualisme cartésien entre la pensée et l’étendue – et peut-être, aussi, de ce qui reste de celui-ci dans le matérialisme spéculatif de Meillassoux – tout en ne concédant rien au corrélationisme. La disjonction diachronique entre la pensée et l’être s’avère n'être pas seulement la conséquence spéculative de la science moderne ; le développement d’une science de la cognition implique que, contrairement à Descartes et à Kant, nous ne puissions pas plus longtemps exempter la pensée de la réalité à laquelle elle donne accès, ou continuer à lui attribuer un statut d'exception.
(1) Après la finitude, p.111.
(2) Ibid., p.28.
(3) C’est le résultat de la réinterprétation de Kant par Heidegger dans Kant et le problème de la métaphysique.
(4) Après la finitude, pp.28-29.
(A SUIVRE)
00:00 | Lien permanent | Commentaires (2)
07/09/2007
Rumor vicinatis

Jean Hyppolite & Georges Canguilhem / Ferdinand Alquié
« Jean Hyppolite (1907-1968), philosophe, spécialiste de Hegel, était le professeur de Deleuze en khâgne au lycée Louis-le-Grand ; devenu professeur à la Sorbonne, il dirigea ensuite (avec Georges Canguilhem) le Diplôme d'Etudes Supérieur que Deleuze avait consacré à Hume ; le mémoire devait paraître aux PUF sous le titre Empirisme et Subjectivité, dans la collection « Epiméthée » dirigée par Hyppolite. Deleuze évoque à plusieurs reprises dans les entretiens son admiration d'étudiant pour Hyppolite auquel Empirisme et Subjectivité est d'ailleurs dédié. » (Lapoujade, note d'éditeur in Deleuze, L'île déserte et autres textes)
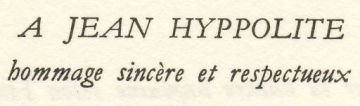
« Après le livre si riche de Monsieur Hyppolite, on pourrait se demander ceci : ne peut-on faire une ontologie de la différence qui n'aurait pas à aller jusqu'à la contradiction, parce que la contradiction serait moins que la différence et non plus ? » (Deleuze, « Jean Hyppolite, Logique et existence », Revue Philosophique de la France et de l'étranger, n°7-9, juillet-septembre 1954)
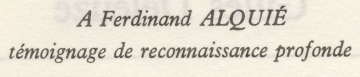

Les « penseurs privés », d'une certaine manière, s'opposent aux « professeurs publics ». Même la Sorbonne a besoin d'une anti-Sorbonne, et les étudiants n'écoutent bien leurs professeurs que quand ils ont aussi d'autres maîtres. Nietzsche en son temps avait cessé d'être professeur pour devenir penseur privé : Sartre le fit aussi, dans un autre contexte, avec une autre issue. Les penseurs privés ont deux caractères : une espèce de solitude qui reste la leur en toutes circonstances ; mais aussi une certaine agitation, un certain désordre du monde où ils surgissent et dans lequel ils parlent. [...] Dès le début Sartre a conçu l'écrivain sous la forme d'un homme comme les autres, s'adressant aux autres du seul point de vue de leur liberté. » (Deleuze, « Il a été mon maître », Arts, 28 novembre 1964)

Ce que Sartre m'a appris, je dirais que c'est tout simplement, quasiment en un sens naïf, l'existentialisme. Mais que veut dire existentialisme ? Cela veut dire la maintenance d'une connexion, d'un lien toujours restituable, entre le concept d'un côté, et de l'autre l'instance existentielle du choix, l'instance de la décision vitale. La conviction que le concept philosophique ne vaut pas une heure de peine si, fût-ce par des médiations d'une grande complexité, il ne renvoie, éclaire et ordonne l'instance du choix, de la décision vitale. Et qu'en ce sens le concept doit être, aussi et toujours, une affaire d'existence. Cela, c'est ce que Sartre m'a appris.
Lacan, lui, m'a appris la connexion, le lien nécessaire entre une théorie des sujets et une théorie des formes. Il m'a appris comment et pourquoi la pensée des sujets elle-même, qu'on avait si souvent opposée à la théorie des formes, n'était en réalité intelligible que dans le cadre de cette théorie. Il m'a appris que le sujet est une question qui n'est pas du tout de caractère psychologique ou phénoménologique, mais que c'est une question axiomatique et formelle. Plus que toute autre question !
Althusser m'a appris deux choses : qu'il n'y avait pas d'objet propre de la philosophie - c'est une de ses grandes thèses -, mais qu'il y avait des orientations de pensée, des lignes de partage. Et, comme l'avait déjà dit Kant, une sorte de combat perpétuel, de combat toujours recommencé, dans des conditions renouvelées. Il m'a appris par conséquent le sens de la délimitation, de ce qu'il appelait la démarcation. En particulier la conviction que la philosophie, ça n'est pas le discours vague de la totalité, ou l'interprétation générale de ce qu'il y a. Que la philosophie doit être délimitée, qu'elle doit se délimiter de ce qui n'est pas elle. La politique et la philosophie sont deux choses distinctes, l'art et la philosophie sont deux choses distinctes, la science et la philosophie sont deux choses distinctes.
Ces trois maîtres se sont donnés à moi dans des modalités très différentes. C'est toujours important de savoir non pas seulement qui a été votre maître, mais dans quelles conditions, dans quels schèmes de maîtrise, vous l'avez rencontré.
Sartre, c'était une dévorante passion adolescente, la passion du livre, la passion de l'existence. Ce n'était pas une personne visible. Je ne l'ai que très peu rencontré. C'était la toute-puissance d'une injonction des livres, la manière dont le livre peut être dévoré, non pas seulement comme un livre, mais comme plus qu'un livre, comme quelque chose qui est une éclaircie et un impératif.
Lacan, c'était pour moi une prose ; j'ai très peu suivi les séminaires. C'était une prose théorique, un style qui combinait, justement dans la prose même, les ressources du formalisme et les ressources de mon seul vrai maître en matière de poème, qui était Mallarmé. Cette conjonction dans la prose, cette possibilité, dans la prose, de la conjonction du formalisme d'un côté (le mathème) et de l'autre de la sinuosité mallarméenne, m'a convaincu que l'on pouvait, en matière de théorie du sujet, circuler en effet entre le poème et la formalisation, donc être avec la plus grande vélocité le lièvre à huit pattes de Bouveresse.
Quant à Althusser, c'est encore une autre figure de maître, car il était, lui, dans l'institution. Il était l'homme caché à l'Ecole Normale Supérieure, il était comme le portier discret et courtois de cette école. Avec lui j'ai appris quelque chose comme une distance, une élégance de la distance. J'en ai tiré, pour la philosophie, qu'elle porte des obligations complexes, qu'elle ne comporte pas un impératif simple mais des obligations enchevêtrées. J'ai toujours mené des activités disparates dans la conviction de la complexité des obligations, subjectives et discursives.
Finalement, j'ai donc pu garder tous mes maîtres. J'ai gardé Sartre contre l'oubli dont il fut longtemps l'objet. J'ai gardé Lacan contre ce qu'il faut bien appeler le caractère terrible de ses disciples. Et j'ai gardé Althusser contre les dures divergences politiques qui, à partir de Mai 68, m'ont opposé à lui. Traversant la possibilité de l'oubli, la dissémination des disciples et le conflit politique, j'ai réussi à conserver la fidélité à trois maîtres disparates. » (Badiou, L'aveu du philosophe)
* * *
Nota Bene :
Si l'on désire vraiment approfondir cette « enquête », à la fois cousue de fil blanc et fort peu humienne, on pourra se référer utilement aux mémoires de Maurice de Gandillac intitulées Le siècle traversé, ce philosophe et grand spécialiste de la Renaissance, reçu la même année que Sartre à l'agrégation de philosophie, qui fut l'ami et le directeur de thèse de Deleuze, et avec lequel il collabora à l'édition des œuvres complètes de Nietzsche chez Gallimard.
Nota Bene 2 :
L'intégralité de l'intervention de Badiou – et donc des anecdotes... – peut se télécharger ici.
Nota Bene 3 :
La "solution" de l'énigme proposée par Badiou en incipit ci-dessus se trouve ici.
00:00 | Lien permanent | Commentaires (3)
05/09/2007
Comitas gentium
« Dans le couloir il y a une glace, qui double fidèlement les apparences. » (Borges)
« Quelquefois l’image, renvoyée de miroir en miroir, nous présente jusqu’à cinq ou six simulacres. Alors les objets placés derrière vous, dans des enfoncements, malgré l’oblique de leur position, et leur distance considérable, à l’aide de ces réflexions répétées, sont tirés de leurs retraits et la multiplicité des miroirs semble les produire dans notre maison. » (Lucrèce)
01:35 | Lien permanent | Commentaires (1)
02/09/2007
Faenus
« Il n'y a plus de déserts. Il n'y a plus d'îles. Le besoin pourtant s'en fait sentir. Pour comprendre le monde, il faut parfois se détourner ; pour mieux servir les hommes, les tenir un moment à distance. Mais où trouver la solitude nécessaire à la force, la longue respiration où l'esprit se rassemble et le courage se mesure ? Il reste les grandes villes. Simplement, il y faut encore des conditions. » (Camus)

« [E]n cette grande ville où je suis, n'y ayant aucun homme, excepté moi, qui n'exerce la marchandise, chacun y est tellement attentif à son profit, que j'y pourrais demeurer toute ma vie sans être jamais vu de personne. Je me vais promener tous les jours parmi la confusion d'un grand peuple, avec autant de liberté et de repos que vous sauriez faire dans vos allées, et je n'y considère pas autrement les hommes que j'y vois, que je ferais les arbres qui se rencontrent en vos forêts, ou les animaux qui y paissent. Le bruit même de leur tracas n'interrompt pas plus mes rêveries, que ferait celui de quelque ruisseau. Que si je fais quelquefois réflexion sur leurs actions, j'en reçois le même plaisir, que vous feriez de voir les paysans qui cultivent vos campagnes ; car je vois que tout leur travail sert à embellir le lieu de ma demeure, et à faire que je n'y aie manque d'aucune chose [...] Quel autre lieu pourrait-on choisir au reste du monde, où toutes les commodités de la vie, et toutes les curiosités qui peuvent être souhaitées, soient si faciles à trouver qu'en celui-ci ? » (Descartes)
20:15 | Lien permanent | Commentaires (1)